Rony MERÇON. Doctorant en sociologie, ED 624 Sciences des Sociétés. Université Paris Cité, UMR 196 CEPED-Centre Population et Développement, IRD. Email : mercon.rony@yahoo.fr. ORCID : https://orcid.org/0009-0000-2263-9700
Introduction
Haïti traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle sans précédent, poussant diverses catégories sociales à quitter le pays. Dans ce contexte, la migration étudiante, en particulier vers la France, connaît une croissance significative. Entre 2016 et 2021, le nombre d’étudiants haïtiens inscrits dans l’enseignement supérieur français a augmenté de 111 %, atteignant 4 440 inscrits, une progression relative qui dépasse celle de toutes les autres mobilités étudiantes vers l’Hexagone (Campus France, 2022). Bien que certains travaux récents aient abordé la mobilité vers la France et la problématique de la fuite des cerveaux (Béchacq, 2019 ; Primo, 2024), les conditions de séjour et d’intégration socioprofessionnelle en France, pourtant déterminantes dans les trajectoires post-diplôme, demeurent largement sous-examinées.
Au-delà des facteurs traditionnels que sont les déterminants éducatifs, historiques et socio-économiques, la mobilité récente et l’installation durable des étudiants haïtiens en France dépendent d’un enchevêtrement complexe de contraintes structurelles, légales et de dynamiques microsociales. Si les approches classiques, telles que les théories push-pull (attraction-répulsion) et/ou celle du capital humain, permettent d’éclairer les motifs de départ des étudiants (Ennafaa et Paivandi, 2008), elles s’avèrent insuffisantes pour appréhender la complexité des parcours migratoires actuels, dans un contexte marqué par la mutation des politiques migratoires et des opportunités d’insertion professionnelle dans les pays d’accueil. En outre, la mobilité étudiante actuelle s’inscrit dans un cadre transnational qui ouvre une pluralité de trajectoires : retour au pays d’origine (Bréant, 2020), installation durable dans le pays d’accueil (Li, 2020), ou encore circulation des compétences (Gaillard et Gaillard, 1999 ; Meyer, 2008). Dès lors, une question centrale se pose : dans quelle mesure les obstacles à l’intégration socioprofessionnelle en France, ainsi que les perspectives — réelles ou perçues — de retour en Haïti, influencent-ils les trajectoires post-diplôme des étudiants haïtiens, notamment dans leur choix entre le retour, l’installation durable ou la réémigration vers un pays tiers ? Par « intégration socioprofessionnelle », nous entendons l’entrée de l’individu sur le marché du travail correspondant à ses attentes, notamment en termes d’adéquation entre le poste occupé et ses qualifications (Béji et Pellerin, 2010 : 563).
Pour répondre à cette question, nous proposons d’examiner dans cet article les déterminants structurels ainsi que les logiques individuelles qui façonnent les trajectoires migratoires, depuis la genèse du projet migratoire dans le pays d’origine jusqu’aux arbitrages post-formation dans le pays hôte. Notre démarche repose sur une investigation empirique articulée autour des expériences vécues par les étudiants haïtiens à travers des enquêtes qualitatives, des données quantitatives secondaires, ainsi qu’un examen des politiques migratoires françaises. Le croisement de ces approches permet de mieux saisir la complexité des parcours migratoires, ainsi que les obstacles structurels, souvent invisibilisés par un discours officiel valorisant l’accueil, tout en mettant en lumière la manière dont les diplômes et les compétences acquises au terme de la formation, bien que porteurs d’un fort potentiel d’intégration professionnelle, se heurtent à des verrous institutionnels.
Les données qualitatives sont issues de deux enquêtes. La première, menée entre 2020 et 2021 dans le cadre d’un mémoire de master, s’est attachée à explorer les trajectoires migratoires et les intentions de retour ou de non-retour d’étudiants haïtiens ayant été formés en France. Fondée sur la méthode des récits de vie (Bertaux, 2010), elle a été conduite auprès de dix (n=10) étudiants. La seconde, menée entre 2022 et 2025 dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours portant sur la coopération universitaire et scientifique entre Haïti et la France, a mobilisé une population d’étude diversifiée[1], incluant vingt-cinq (n=25) étudiants haïtiens en France interrogés selon la même approche méthodologique. L’analyse présentée dans cet article s’appuie spécifiquement sur l’ensemble des données recueillies auprès de ces trente-cinq enquêtés (n = 35). Sélectionnés via des réseaux d’interconnaissance, les participants ont été choisis selon une logique de diversification des profils académiques : 25 hommes et 10 femmes, comprenant 6 docteurs, 14 doctorants et 15 étudiants en master (la plupart de ces derniers ont déjà effectué un premier cursus de master en France et sont titulaires d’un diplôme de Master 2). Inscrits ou diplômés dans une dizaine d’universités françaises — majoritairement en Île-de-France — et issus de disciplines variées, la quasi-totalité d’entre eux ont autofinancé leur projet de mobilité et sont arrivés en France entre 2010 et 2023. Les entretiens ont porté sur trois axes principaux : la genèse et la mise en œuvre du projet de formation, les conditions de séjour et d’insertion professionnelle pendant ou après leur formation en France, ainsi que les projections de retour ou de non-retour. En complément de ces enquêtes, nous avons également mobilisé des données quantitatives provenant de sources institutionnelles telles que le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), Campus France, entre autres.
L’article s’organise en quatre parties. Premièrement, nous analyserons le rôle de la crise systémique haïtienne dans l’émergence des projets migratoires. Deuxièmement, nous étudierons l’ambivalence des politiques migratoires françaises, tiraillées entre volonté d’attraction et logique de sélection, et leur impact sur les parcours des étudiants. Troisièmement, nous identifierons les obstacles structurels entravant l’intégration socioprofessionnelle. Enfin, nous interrogerons la question du retour, en montrant comment les difficultés d’insertion en France et les obstacles structurels au retour en Haïti contribuent à (ré)orienter les parcours vers des choix différenciés.
1. Crise haïtienne et motivations de la migration étudiante vers la France
Le système d’enseignement supérieur haïtien, tributaire de la crise sociétale chronique et multidimensionnelle (Dorvilier, 2012), peine à répondre à la demande croissante de formations supérieures. Alors qu’à la fin des années 1980, 5 315 élèves en moyenne obtenaient le diplôme de fin d’études secondaires, ce chiffre est passé à 43 213 pour la période 2011-2017, or les institutions d’enseignement supérieur n’ont pu accueillir que 61,17 % de cet effectif (Figure 1). À cette offre limitée s’ajoute une structuration duale de l’enseignement supérieur. D’un côté, un secteur public dont les capacités d’accueil sont fortement restreintes, ne représentant qu’environ 11 % des 177 établissements officiellement reconnus (Vincent et Dona, 2024). De l’autre, un secteur privé en expansion rapide, assumant une fonction compensatoire face à un afflux croissant de diplômés du secondaire arrivant sur le marché de l’enseignement supérieur, mais dont ni la qualité des formations ni l’accessibilité financière ne sont garanties (Jacob, 2020 : 372).
Figure 1 : Nombre de diplômés de l’enseignement secondaire et taux d’admission dans l’enseignement supérieur et 1987-2017
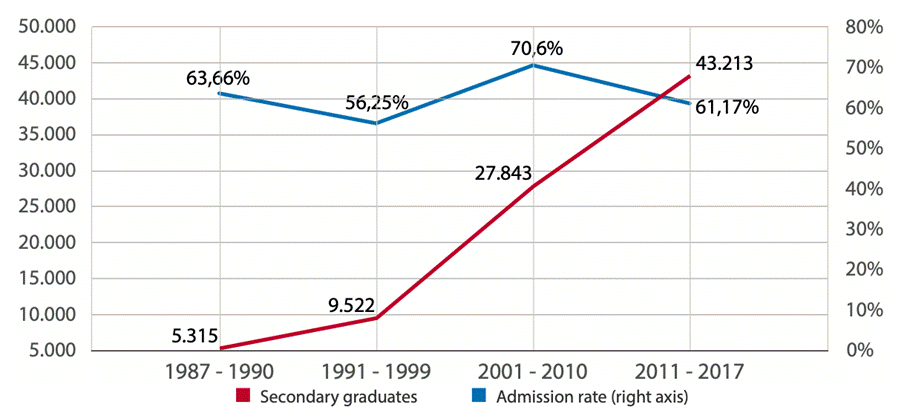
Source : Reproduit dans Sergot Jacob (2023 : 8) à partir des données MENFP.
De surcroît, cette inadéquation structurelle se manifeste de manière encore plus marquée aux cycles supérieurs. Alors que la demande pour les formations de niveau master tend en effet à augmenter, et que celle relative au doctorat, bien qu’encore marginale, commence néanmoins à émerger, l’offre demeure pourtant très largement concentrée sur le niveau de la licence. En dépit des efforts déployés au cours de la dernière décennie pour renforcer le système d’enseignement supérieur avec notamment la création de nouveaux programmes de master, ces derniers restent sous-dotés en ressources matérielles, financières et en équipements modernes. Quant au Collège doctoral d’Haïti (CDH)[2], créé à la suite du séisme de 2010 avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de l’Ambassade de France, il demeure à un stade embryonnaire de développement : les thèses sont, pour l’instant, menées en cotutelle avec des universités étrangères. L’autonomisation de ce dispositif doctoral, ainsi que son intégration dans un système Licence-Master-Doctorat (LMD) doté d’un processus d’accréditation effectif, nécessitent d’importants investissements en ressources humaines et financières, afin d’en renforcer la qualité et l’attractivité.
Cette précarité institutionnelle s’inscrit dans un contexte socio-économique particulièrement alarmant, caractérisé par un taux de chômage affectant plus de 60 % de la population active (International Organisation of Employers, 2023) et une expansion sans précédent de la violence des gangs armés, qui contrôlent désormais plus de 80 % de Port-au-Prince (BINUH, 2025 : 12) et ne cessent de s’accroître (Figure 2)[3]. Cette situation de violence et de dégradation des conditions de vie de la population a provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes à l’intérieur du pays (OIM, 2024) et a alimenté une vague d’émigration externe touchant l’ensemble des couches sociales, y compris les étudiants.
Figure 2 : Homicide volontaire, par genre et par âge, 2020-2024
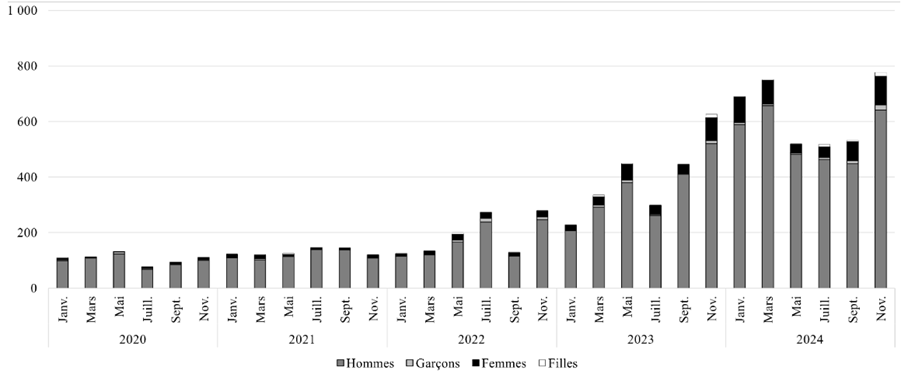
Source : Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) (2025 : 19)
Si la France constitue historiquement l’une des destinations privilégiées de la migration étudiante haïtienne, en raison de liens linguistiques, de la reconnaissance internationale de ses diplômes ainsi que de sa réputation traditionnelle comme « lieu et source du savoir » (Delachet-Guillon, 1996 : 43), les données issues de nos enquêtes mettent en exergue une évolution des motivations migratoires. Désormais, la faiblesse structurelle du système de l’enseignement supérieur haïtien, conjuguée à la détérioration des conditions socioéconomique et sécuritaire du pays, constituent les principaux facteurs explicatifs de ces flux migratoires.
Les récits recueillis auprès des enquêtés permettent d’identifier deux carences majeures perçues dans le système universitaire haïtien, lesquelles constituent des facteurs déterminants dans leur décision de départ. La première est une inadéquation manifeste entre l’offre de formation et les aspirations des étudiants. La seconde relève d’une instabilité institutionnelle chronique, marquée par des grèves prolongées et des interruptions fréquentes des activités académiques. Le témoignage de Steeve (34 ans, doctorant en information-communication) illustre ce constat :
« Après ma licence […], aucune formation de master ne correspondait à mon projet […] Et puis, je ne me voyais pas entamer mon master en Haïti, dans les mêmes conditions qu’en licence, avec tous les problèmes d’infrastructures, de documentation et de grèves dans les facultés. »
Plus encore, la dégradation sécuritaire agit comme un catalyseur de la migration étudiante. Louna (28 ans, étudiante en master 1 de psychanalyse), arrivée en France en 2019, témoigne d’un départ motivé avant tout par la recherche de sécurité : « Avec cette insécurité, je ne pensais qu’à quitter mon pays ». Son parcours témoigne également des concessions consenties pour concrétiser son projet de départ : bien qu’elle ait déjà obtenu une licence en Haïti, elle a accepté de reprendre une troisième année de licence, estimant que cela lui offrait une chance d’obtenir un visa et d’échapper à ce contexte d’insécurité.
L’analyse des entretiens met également en lumière le poids des considérations économiques dans le choix de la France comme destination. Les coûts relativement bas de l’enseignement supérieur français, en comparaison avec ceux des pays anglo-saxons, apparaissent comme un facteur décisif. Staniola (28 ans, master 2 en littérature) souligne : « À 243 euros par an, je fais mon master. Aux États-Unis et au Canada, il faut compter 30 000 dollars, voire plus ». Elle exprime toutefois une inquiétude face à l’augmentation récente des frais pour les étudiants étrangers : « C’est dommage qu’on veuille maintenant faire payer plus cher les étudiants étrangers ». Ce propos fait référence à la politique dite « Bienvenue en France », qui a introduit en 2019 une tarification différenciée pour les étudiants extracommunautaires (nous nous y reviendrons plus loin).
Nos données montrent également que le projet d’études à l’étranger ne résulte pas uniquement d’une décision individuelle, mais s’inscrit souvent dans des dynamiques familiales. Le soutien de la famille joue, en effet, un rôle déterminant dans la concrétisation de ces projets. La migration étudiante y est fréquemment perçue comme une stratégie d’ascension sociale, portée par une représentation « idéalisée » de la diaspora haïtienne. Si le concept de diaspora, défini étymologiquement comme la dispersion d’un peuple au-delà de ses frontières d’origine, a connu des usages fluctuants (Dufoix, 2011), son appropriation dans le contexte haïtien revêt en effet une singularité à la fois sémantique et sociologique. Le terme « dyaspora », masculin en créole haïtien, désigne, comme le souligne Cédric Audebert (2012 : 12), à la fois l’individu d’origine haïtienne résidant ou né à l’étranger, et le symbole de réussite socioéconomique qu’il incarne. Cette représentation de la figure du migrant, ainsi que l’idéalisation de l’« ailleurs » — souvent désigné par l’expression créole « lòt bò dlo » (« l’autre bord de l’eau ») — comme espace d’opportunités économiques et personnelles, contribuent à forger un certain imaginaire de l’espace diasporique, proche de ce que Thomas Fouquet (2007) désigne comme un « imaginaire migratoire ». Cet imaginaire renvoie à un ensemble de représentations fantasmées de l’ailleurs, le plus souvent associé aux sociétés du Nord, perçues comme « dépositaire des aspirations à un mieux-être et à un mieux-vivre » (Fouquet, 2007 : 84).
Si cet imaginaire construit autour de la migration perd aujourd’hui en valeur symbolique dans un monde désormais globalisé, façonné par les réseaux sociaux et les flux numériques, il conserve néanmoins une force mobilisatrice, soutenue par une réalité économique tangible : les transferts de fonds de la diaspora haïtienne. En effet, depuis le début des années 2000, ces transferts monétaires en provenance de la diaspora ne cessent de croître, notamment après le séisme de 2010, et sont estimés, pour la période 2021-2022, à environ 3,41 milliards de dollars américains, soit plus de 20 % du produit intérieur brut (PIB) (BRH, 2024 : 7). Ils constituent un filet de sécurité essentiel pour les familles restées au pays, en finançant des besoins fondamentaux tels que le logement, l’alimentation, les soins médicaux et l’éducation.
S’inscrivant dans cette perspective, la migration étudiante vise non seulement à favoriser la mobilité et l’ascension sociale de l’étudiant migrant, mais également à soutenir économiquement la famille restée dans le pays d’origine. Toutefois, cette dynamique porteuse de promesses individuelles et collectives se heurte à l’ambivalence croissante des politiques migratoires françaises. Tiraillées en effet entre des impératifs d’attractivité et des logiques de sélection, elles tendent à complexifier les démarches administratives et à entraver, de façon croissante, les projets de migration étudiante.
2. Politiques migratoires françaises : une « attractivité sélective »
Le durcissement du contrôle de l’immigration étudiante en France s’inscrit dans une logique de régulation des flux migratoires, amorcée dès les années 1970. Les autorités françaises percevaient en effet les « étudiants étrangers[4] » extracommunautaires, et plus particulièrement ceux originaires de pays en voie de développement, comme de « potentiels immigrés permanents ». Dans cette optique, plusieurs dispositifs restrictifs ont été mis en place, parmi lesquels la « circulaire Bonnet » (1977), qui imposait aux étudiants étrangers de regagner leur pays d’origine après l’obtention de leur diplôme, sous peine de non-renouvellement de leur titre de séjour, ainsi que le « décret Imbert » (1979), qui exigeait une préinscription universitaire depuis le pays d’origine et la validation préalable d’un niveau suffisant de maîtrise du français (Blum Le Coat et Moguérou, 2014 ; Kabbanji et Toma, 2020). Ces mesures visaient explicitement à limiter l’octroi de visas étudiants, à restreindre l’accès à un séjour permanent et à encadrer strictement les possibilités d’emploi pendant et après les études.
Bien que la loi du 24 juillet 2006, promue par Nicolas Sarkozy, ait introduit le principe d’« immigration choisie » en assouplissant l’accès au marché du travail pour les diplômés étrangers, et que la circulaire du 31 mai 2012 ait facilité l’obtention d’un titre de séjour pour un premier emploi en adéquation avec la formation suivie (Blum Le Coat et Moguérou, 2014 : 124), le droit au séjour des étudiants étrangers demeure marqué par une logique de sélection de plus en plus restrictive (Kabbanji et Toma, 2020). Cette tendance s’est accentuée avec la mise en place du programme « Bienvenue en France » en 2018[5], dont l’ambition déclarée de renforcer l’attractivité internationale des universités françaises s’est paradoxalement accompagnée d’une augmentation drastique des frais d’inscription pour les étudiants extracommunautaires. La récente loi du 26 janvier 2024, dite « loi Darmanin »[6], vient parachever cette orientation en instaurant des mesures discriminatoires telles qu’une caution de retour obligatoire et des restrictions d’accès aux aides sociales, fragilisant davantage les conditions de séjour de ces populations.
Les candidats haïtiens subissent particulièrement les effets de ce durcissement, confrontés à un double mécanisme de sélection, à la fois administratif et financier. Le processus migratoire, désormais centralisé par Campus France, repose sur une évaluation en deux phases : une première étape de préinscription universitaire assortie d’un entretien visant à évaluer la cohérence du projet académique et la maîtrise de la langue française (niveau B2 minimum[7]), suivie de la demande de visa, nécessitant des justificatifs de ressources (615 € mensuels), d’hébergement. À cela s’ajoutent d’autres frais, dont ceux liés au traitement de dossier par Campus France, qui ne cessent de s’accroître (passés de 5 800 à 8 500 gourdes entre 2019 et 2024, soit une hausse de 46 %) ainsi que les frais consulaires de 50 €. Le témoignage de Jacky (27 ans, étudiant en master d’histoire des sciences) illustre ces obstacles :
Pour venir en France, ça a été une vraie galère. Pour prouver que j’avais le montant exigé, j’ai reçu et emprunté de l’argent à plusieurs de mes proches : ma famille, mes amis et un oncle que j’ai aux États-Unis […] Après tout ça, il y a les frais de dossier, le billet d’avion […] C’est comme ça ! C’est compliqué ! Bon, après, les étudiants se débrouillent comme ils peuvent pour obtenir le visa.
Ces propos, à l’instar de nombreux autres témoignages, mettent en lumière les difficultés rencontrées par les candidats. Certains, dépourvus de capitaux économiques et sociaux suffisants, se voient parfois contraints d’abandonner leur projet d’études en France. Inscrites dans la compétition mondiale pour l’attraction des « talents » (Kapur et McHale, 2005) et dans le processus de marchandisation de l’enseignement supérieur (Van Zanten, 2023), les politiques migratoires françaises, à travers les « pouvoirs discrétionnaires » délégués aux fonctionnaires de structures telles que Campus France ou les ambassades, reposent sur une logique de sélection, privilégiant les profils perçus comme « talentueux » ou financièrement solvables.
Il en va de même pour les universités. Dans un contexte de « course à l’excellence » (Musselin, 2017), celles-ci tendent à renforcer leurs critères d’admission, notamment dans les filières liées aux sciences de l’ingénierie, aux disciplines techniques et expérimentales. Cette dynamique conduit à favoriser les candidats issus de « pays technologiquement avancés », au détriment de ceux originaires de contextes structurellement fragiles, disposant de faibles infrastructures scientifiques et technologiques ainsi que de ressources financières limitées, comme Haïti. Une responsable de la Conférence des présidents d’université (CPU), structure devenue aujourd’hui « France Universités » (FU), confie, lors d’un entretien :
J’ai une expérience qui m’a attristée : un candidat haïtien en agronomie. Le type est intéressant, très réactif, très organisé. Il a fait sa demande dans plusieurs universités […] Il est refusé partout. J’avoue que j’étais surprise. Deux fois, j’ai écrit au vice-président relations internationales en disant regarder ce dossier, ça me parait bien, penser à la situation en Haïti. Mais je ne suis pas capable de connaître leurs exigences et en quoi ça ne passait pas […] J’ai l’impression que dans certaines filières, les universités mettent la barre très haut.
Cette sélection structurelle opérée par les établissements d’enseignement supérieur, combinée aux défis rencontrés par les universités haïtiennes pour former un nombre suffisant d’étudiants dans certaines disciplines scientifiques ou expérimentales selon les standards internationaux, contribue vraisemblablement à la prédominance des étudiants dans les filières littéraires ainsi que dans les sciences humaines et sociales. Les données publiées par Campus France (2024) pour l’année universitaire 2023-2024 illustrent clairement ce déséquilibre : 1 158 inscriptions ont été enregistrées en lettres et sciences humaines, 1 035 en sciences économiques et 657 en sciences juridiques et politiques, contre seulement 615 en sciences de l’ingénieur et 212 en médecine.
Si cette migration étudiante continue de croître malgré des mesures de plus en plus contraignantes, c’est non seulement en raison de la persistance des liens historico-culturels hérités de l’histoire coloniale, mais aussi et surtout grâce à l’implication active des réseaux familiaux haïtiens, souvent organisés autour de stratégies collectives de soutien financier. Cette mobilisation est perçue comme un véritable investissement, dont les retombées potentielles, tant pour l’étudiant que pour sa famille, sont appelées à compenser largement les efforts et les sacrifices consentis.
3. Séjour précaire et obstacles structurels à l’insertion professionnelle
Les étudiants étrangers non boursiers arrivant en France doivent faire face à plusieurs obstacles, parmi lesquels le logement figure en première place. Ce dernier représente un défi majeur, notamment en Île-de-France, où la pression immobilière est particulièrement forte (Pinto Baleisan, 2014). Le système d’attribution des résidences universitaires, principalement réservé aux bénéficiaires de bourses de la coopération française, contraint les autres à se tourner vers le marché locatif privé, dont les exigences — garanties élevées et justificatifs de revenus stables — restent souvent hors de portée.
Face aux difficultés d’accès au logement, le nouvel arrivant haïtien est fréquemment accueilli par ses compatriotes, selon une logique de solidarité. À cet égard, les propos d’Olivier (33 ans, doctorant en philosophie) sont particulièrement révélateurs :
Nous étions trois dans un T1 de 28 m², deux autres compatriotes haïtiens et moi. Un matin, nous avons reçu un appel d’un ami : « les gars, il faut héberger telle personne qui vient d’arriver, elle n’a personne, c’est un ami ». On est passé à quatre. Moins de deux semaines après, un autre ami nous a appelés : « je suis en auberge de jeunesse et je paie 20 euros tous les jours. Là, je n’ai presque plus d’argent ». On a été obligés de l’accueillir. Ça fait cinq ! Heureusement, d’autres amis ne nous ont pas contactés. On était resté à cinq pendant cinq mois.
Cette forme d’entraide fait écho à ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan, cité par David Mahut (2017 : 128), désigne comme une « obligation morale d’assistance mutuelle », dans laquelle il est parfois difficile de refuser un service à un parent, un ami, un proche, ou encore une personne recommandée par ceux-ci. Dans la société haïtienne, où les liens communautaires sont particulièrement forts, le cercle des personnes envers qui l’on se sent redevable ou moralement tenu d’agir par solidarité est relativement étendu. Toutefois, cette solidarité révèle rapidement ses limites en contexte de précarité prolongée dans le pays d’accueil, comme l’a souligné Claude Delachet-Guillon (1996 : 123) : « lorsque l’hébergement chez les accueillants se prolonge, les contraintes de la vie en région parisienne, et l’individualisme français ambiant […] finissent par avoir raison du devoir d’entraide, surtout si le nouvel arrivant ne trouve pas de travail et ne peut pas payer sa quote-part des dépenses quotidiennes. » Le nouvel arrivant est dès lors contraint d’assumer seul l’intégralité de ses charges, devant pourvoir à tous ses besoins matériels et financiers de manière autonome.
Or, intégrer le marché du travail ne va pas de soi. Il convient de rappeler que le statut d’étudiant ne confère pas automatiquement le droit d’exercer une activité professionnelle à titre principal en France. Comme mentionné précédemment, le visa et le titre de séjour étudiant limitent la présence sur le territoire à la seule poursuite d’études, n’autorisant qu’un emploi accessoire. L’exercice d’un emploi à temps plein suppose un changement de statut vers un titre de séjour « salarié ». En conséquence, les étudiants sont souvent contraints d’accepter des emplois précaires à temps partiel, dont les revenus demeurent généralement insuffisants. Le poste d’assistant d’éducation (AED)[8], fréquemment occupé par ces derniers (11 sur 35 enquêtés), constitue un exemple typique. Bien qu’il offre une certaine flexibilité horaire, ce contrat à durée déterminée (CDD) permet difficilement de joindre les deux bouts, avec une rémunération moyenne avoisinant les 600 euros nets mensuels pour un mi-temps. Les parcours de quelques étudiants présentés ailleurs (Jamid, Makki, et Merçon, 2021), illustrent avec acuité la tension constante entre exigences académiques et impératifs économiques, révélant ainsi la vulnérabilité structurelle dans laquelle se trouvent nombre d’étudiants étrangers en France.
Pour envisager une installation permanente en France après les études, l’accès à un emploi stable constitue une condition sine qua non. La conversion du titre de séjour étudiant en titre salarié est conditionnée par l’obtention d’un poste en adéquation avec le niveau de qualification. En l’absence de cette transition statutaire — ou d’une naturalisation[9] —, les diplômés s’exposent au « risque d’irrégularité », pouvant d’aboutir à une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cela étant, l’accès à l’emploi apparaît à la fois comme un impératif de survie et une nécessité administrative.
Parmi les entraves à l’insertion professionnelle figurent les contraintes administratives et les discriminations à l’embauche, conduisant souvent à des situations de déclassement. À ce sujet, François Héran (2017 : 287) note : « dans la plupart des pays européens, Royaume-Uni excepté, le taux de chômage des immigrés est deux fois plus élevé que celui des natifs […] Lorsqu’ils ont un emploi, ils sont plus nombreux à subir un déclassement : un tiers des immigrés diplômés du supérieur exercent un emploi de niveau moyen ou inférieur ». Cette réalité de déclassement est bien connue en France (Malroux, Auriol-Desmulier, et Gosselin, 2023).
L’évolution récente du marché de l’emploi dans certains secteurs en tension, comme celui de l’Éducation nationale, s’est traduite par un recours accru aux enseignants contractuels pour pallier la pénurie d’enseignants (Pons, 2021), ouvrant ainsi des opportunités d’emploi pour de nombreux diplômés étrangers, notamment haïtiens (9 sur 35). Toutefois, ce poste de « professeur des écoles » s’accompagne souvent d’une double précarité : d’une part statutaire, du fait du caractère non permanent du contrat ; d’autre part identitaire, en raison du statut d’étranger ou d’immigré. Si, comme le souligne Xavier Pons (2021 : 68), la « hiérarchie symbolique traditionnelle » entre titulaires et contractuels tend à s’atténuer, nos entretiens révèlent la persistance de formes de stigmatisation, portant tant sur la légitimité pédagogique que sur l’accent, perçu comme un marqueur d’altérité. Cette situation conduit certains, comme Jacky, à ne pas renouveler leur contrat à l’issue d’une première expérience jugée décevante, voire discriminatoire.
Certains diplômés haïtiens, bien qu’ayant réussi à changer de statut, se retrouvent en fait dans des emplois inférieurs à leur qualification, souvent dans des secteurs marqués par des besoins non pourvus (Éducation nationale, médico-social, restauration). Ce décalage entre capital académique et reconnaissance professionnelle traduit une inadéquation persistante entre les compétences acquises et les dynamiques du marché de l’emploi. Il s’accompagne d’un profond hiatus : les postes occupés sont souvent éloignés des aspirations initiales qui avaient motivé le projet migratoire.
D’autres diplômés, confrontés à l’impossibilité d’obtenir un emploi permettant un changement de statut, adoptent des stratégies alternatives. La plus courante consiste à prolonger le statut étudiant via l’inscription dans de nouveaux cursus — souvent des masters — tout en cumulant des « petits boulots » précaires. Si ces réinscriptions peuvent parfois correspondre à un intérêt intellectuel réel, elles relèvent souvent de tactiques d’évitement des contraintes administratives : différer le retour au pays — rendu pratiquement impensable par l’aggravation de la situation sécuritaire en Haïti — ou attendre l’émergence d’opportunités professionnelles en France ou dans un autre pays. La crise sanitaire du COVID-19 (Belghith et al., 2020) qui a accentué cette vulnérabilité structurelle, révélait les failles du système d’accueil français à l’égard des étudiants étrangers. Nombre d’entre eux se retrouvent ainsi dans une situation similaire à ce que Yong Li (2020) qualifie d’« immobilité dans la mobilité » : bien que diplômés en France, ils demeurent piégés dans une précarité prolongée — emplois instables, difficultés à concrétiser des projets familiaux ou résidentiels — qui compromet sérieusement leurs projets professionnels.
Le bilan exprimé par les enquêtés est marqué par une forte ambivalence. Si la réussite universitaire est acquise, l’insertion socioprofessionnelle reste un combat quotidien. Cette tension engendre un sentiment de stagnation, comme le témoigne Bernard (34 ans, doctorant en droit) : « Malgré mon master obtenu en France, trouver un emploi valorisant n’est pas une chose facile. » Ce décalage entre le niveau de qualification et le sous-emploi, que certains qualifient de « gaspillage des cerveaux » (Brain Waste) (Özden, 2005), soulève, in fine, la question cruciale du retour ou du non-retour au pays d’origine.
4. Retour, installation ou indécision : des trajectoires sous contraintes
L’analyse des réponses à la question du retour en Haïti fait apparaître une typologie ternaire au sein de la population étudiée : certains envisagent un retour (n = 7), d’autres optent pour une installation durable en France (n = 9), tandis qu’une majorité demeure dans l’incertitude (n = 19). Si ces proportions, issues d’un effectif limité de 35 entretiens, doivent être interprétées non comme des données statistiques généralisables mais comme des configurations discursives significatives, elles n’en éclairent pas moins, avec justesse, les tensions structurelles et les dilemmes subjectifs auxquels ces étudiants sont confrontés en fin de parcours universitaire. Cette répartition met en lumière, de manière particulièrement révélatrice, l’articulation complexe entre contraintes objectives et dynamiques subjectives dans les trajectoires migratoires.
Les étudiants envisageant un retour en Haïti fondent leur décision sur une combinaison de considérations économiques et d’ancrages identitaires. Sur le plan professionnel, ces diplômés redoutent un avenir marqué par le déclassement en France, alors qu’ils estiment pouvoir bénéficier d’une réinsertion plus valorisante dans leur pays d’origine. C’est le cas, par exemple, de Staniola, ancienne enseignante assurée de réintégrer son poste, voire d’accéder à un poste supérieur. À ces considérations pragmatiques s’ajoutent des dimensions affectives et symboliques : l’attachement familial, le sentiment de responsabilité patriotique ainsi que le désir d’être présent sur place et de contribuer au développement national sont fréquemment évoqués. Ces éléments traduisent un vécu ambivalent, traversé par un tiraillement à la fois identitaire et existentiel.
À l’opposé, les étudiants ayant opté pour une installation durable en France invoquent d’abord l’insécurité, puis le chômage comme deux principaux facteurs de dissuasion. Cette appréhension s’inscrit dans une logique familiale élargie : le soutien matériel et moral mobilisé au sein du réseau de proches pour concrétiser le projet migratoire génère une pression implicite de réussite, rendant inenvisageable tout retour sans débouché professionnel. L’exacerbation continue de la crise sécuritaire, dont les témoignages quotidiens relayés par les réseaux sociaux et les proches restés au pays, accentue cette réticence. En outre, les processus d’ancrage progressif en France, par le biais du mariage ou de la scolarisation des enfants, contribuent à stabiliser ces choix, comme en témoignent les propos de Philippe, docteur en sciences de l’éducation, installé en France depuis douze ans :
« Je reste en France surtout parce que j’ai une famille. Vous connaissez la situation actuelle en Haïti : les assassinats, les kidnappings […] Je ne peux quand même pas aller exposer ma famille à ça. Et en plus, je pense qu’en France, mon fils bénéficie d’une meilleure scolarisation. »
La majorité des enquêtés, en situation d’indécision, manifeste une ambivalence profonde quant à la perspective de retour, révélatrice des tensions constitutives des migrations étudiantes contemporaines. Cette indétermination ne saurait être interprétée comme un simple manque de volonté ou de résolution personnelle, mais plutôt comme une réponse adaptative à un environnement migratoire particulièrement contraignant. Elle repose sur un enchevêtrement de considérations : d’un côté, un attachement à Haïti, ravivé par les difficultés d’intégration en France ; de l’autre, une lucidité face aux défis concrets d’une réinsertion professionnelle dans un contexte national fragilisé, marqué par l’effritement des institutions éducatives, l’insécurité endémique et le manque chronique de débouchés. La décision à prendre demeure tributaire de l’évolution de la crise haïtienne ainsi que des opportunités professionnelles susceptibles d’émerger en France ou dans des pays tiers. Autrement dit, cette posture vise à maintenir ouvertes toutes les perspectives, tout en différant toute décision hâtive…
En outre, l’analyse des données révèle deux tendances significatives. Premièrement, face à la tension générée par les défis d’intégration en France et l’impossibilité d’envisager un retour en Haïti comme solution viable, émergent des stratégies migratoires de contournement. Parmi celles-ci figurent la réémigration vers des pays tiers, perçus comme offrant de meilleures perspectives d’accueil et d’insertion socioprofessionnelle. Un nombre croissant d’étudiants considèrent la France, en définitive, non comme une destination finale, mais comme une étape transitoire vers d’autres pays. Les trajectoires de Louna (partie aux États-Unis après son master) et de Daniel (installé au Canada à l’issue de son doctorat) illustrent clairement cette logique de réémigration. Il convient de souligner, en particulier, le Canada, fréquemment évoqué dans les discours recueillis. De nombreux étudiants y font référence en mentionnant des camarades, collègues ou amis ayant quitté la France après leur formation pour s’y établir[10].
Deuxièmement, au-delà de la diversité des trajectoires individuelles, une constante se dégage : la majorité des enquêtés manifeste une ambivalence profonde, oscillant entre un attachement viscéral à Haïti et une frustration croissante face à l’impossibilité d’y envisager un avenir professionnel stable et valorisant, et, par extension, de contribuer au développement du pays. Ce paradoxe est d’autant plus prégnant qu’Haïti ne dispose ni d’une politique volontariste ni de mécanismes institutionnels destinés à encourager le retour de ses diplômés de l’étranger ou leur mobilisation à distance.
Conclusion
La présente étude a analysé les dynamiques qui, ces dernières décennies, ont façonné les trajectoires migratoires des étudiants haïtiens en France, depuis la genèse de leur projet dans leur pays d’origine jusqu’aux choix déterminants opérés à l’issue de leur parcours académique, en passant par les obstacles rencontrés lors de leur insertion socioprofessionnelle. Si des facteurs historiques, tels que le coût relativement abordable des études et l’héritage colonial, continuent de faire de la France une destination académique privilégiée, les migrations actuelles sont motivées avant tout par une double carence : l’incapacité structurelle de l’université haïtienne à répondre à la demande croissante de formation supérieure et la dégradation accélérée des conditions socioéconomiques et sécuritaires en Haïti.
En France, ces étudiants se heurtent à des obstacles structurels aggravés par des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Le durcissement administratif, l’érosion des droits sociaux et les barrières à l’accès à l’emploi qualifié limitent leurs perspectives d’insertion professionnelle. Ce contexte engendre un paradoxe : alors que le discours officiel promeut l’attractivité étudiante, les dispositifs juridiques et institutionnels en restreignent l’accueil et les conditions de séjour, au profit d’une immigration de plus en plus sélective et différenciée. Parallèlement, l’exacerbation de la crise haïtienne obère les perspectives de retour constructif, plaçant les diplômés dans une situation délicate où émergent différentes trajectoires post-formation : le retour au pays, motivé par les difficultés d’insertion socioprofessionnelle en France ; le maintien en France ou la réémigration vers des pays tiers, envisagés comme des recours face à l’inviabilité d’un retour constructif en Haïti ; ou encore l’indécision, qui concerne la majorité de nos enquêtés, indécision qui reflète la complexité des choix.
Ainsi se dessine une configuration dans laquelle Haïti, la France et les diplômés apparaissent, chacun à leur manière, en partie, « perdants ». Les diplômés, confinés à des statuts précaires, ne peuvent valoriser pleinement leurs compétences. Haïti voit s’exiler une part inquiétante de ses ressources humaines hautement qualifiées, fruit d’un investissement éducatif déjà fragilisé. La France, bien qu’ayant assuré ou contribué à la formation supérieure de ces diplômés, érige des barrières institutionnelles qui entravent leur insertion et poussent certains à réémigrer vers des pays tiers. Cette dynamique appelle, dès lors, des réflexions renouvelées sur les politiques de coopération académique entre la France et Haïti, ainsi que sur la mise en place de mécanismes capables d’articuler la mobilité étudiante internationale et le développement local.
Références bibliographiques
Audebert, Cédric. (2012). La diaspora haïtienne : Territoires migratoires et réseaux. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
Banque de la République d’Haïti (BRH)-Infos à la loupe. (2024). Les transferts sans contrepartie : tendance, distribution et dynamique du marché https://www.brh.ht/wp-content/uploads/Transferts-sans-contreparties-tendance-distribution-et-dynamique-du-marche.pdf Consulté en ligne le 5/02/2025.
Béchacq, Dimitri. (2019). Les étudiants haïtiens en France : D’une instruction élitiste aux vécus migratoires contemporains. Recherches Haïtiano-Antillaises. https://hal.univ-antilles.fr/hal-02292538 Consulté en ligne le 16/05/2023
Béji, Khemais, et Pellerin, Audrey. (2010). Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de l’information et des réseaux sociaux. Relations industrielles/Industrial Relations. 65(4) : 562-583.
Belghith, Feres, Ferry, Olivier, Patros, Tiphaine, et Tenret, Élise. (2020). La vie étudiante au temps de la pandémie de Covid-19 : Incertitudes, transformations et fragilités. Observatoire national de la vie étudiante. https://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-etudiante-au-temps-du-COVID-19.pdf Consulté en ligne le 13/02/2021.
Bertaux, Daniel. (2010). L’enquête et ses méthodes : Le récit de vie (3ᵉ éd.). Paris : Armand Colin.
Blum Le Coat, Jean-Yves, et Moguérou, Laure. (2014). « Chapitre 6 : Scolarisation des immigrés et migration pour études ». In Jean-Yves Blum Le Coat & Michel Eberhard (dir.). 2014. Les immigrés en France. Paris : La Documentation française : 109-132.
Bréant, Hugo. (2020). Réinstallations d’émigrés africains : Les usages sociaux des diplômes étrangers. Migrations Société. 180(2) : 83-96.
Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH). (2025). Rapport du Secrétaire général, Conseil de sécurité des Nations Unies. https://docs.un.org/fr/S/2025/226 Consulté en ligne le 9/05/2025.
Campus France. (2022). Rentrée : La France affiche une augmentation record du nombre d’étudiants internationaux. https://www.campusfrance.org/fr/rentree-2022-la-france-affiche-une-augmentation-record-du-nombre-d-etudiants-internationaux Consulté en ligne le 05/10/2022.
Campus France. (2024). Fiche mobilité Haïti. https://www.campusfrance.org/fr/generate-url/304581/0?hash=d32cd8b65c9287106e41d173d07f23933b68d360d5690368bb2d6863294e9389 Consulté en ligne le 10/01/2025.
Delachet-Guillon, Claude. (1996). La communauté haïtienne en Ile-de-France. Paris : L’Harmattan.
Dorvilier, Fritz. (2012). La crise haïtienne du développement : Essai d’anthropologie dynamique. Port-au-Prince : Éditions de l’Université d’Haïti.
Dufoix, Stéphane. (2011). La dispersion : Une histoire des usages du mot diaspora. Paris : Éditions Amsterdam.
Ennafaa, Ridha, et Paivandi, Saeed. (2008). Le non-retour des étudiants étrangers : Au-delà de la « fuite des cerveaux ». Formation Emploi. 103 : 23-39.
Erlich, Valérie, Gérard, Étienne, et Mazzella, Sylvie. (2021). La triple torsion des mobilités étudiantes : Financiarisation de l’enseignement supérieur, concurrence sur le marché mondial et différenciations sociales accrues des parcours. Agora débats/jeunesses,88(2) : 53-69.
Fouquet, Thomas. (2007). Imaginaires migratoires et expériences multiples de l’altérité : Une dialectique actuelle du proche et du lointain. Autrepart, 41(1) : 83-98.
Gaillard, Anne-Marie, et Gaillard, Jacques. (1999). Les enjeux des migrations scientifiques internationales : De la quête du savoir à la circulation des compétences. Paris : L’Harmattan.
Héran, François. (2017). « Chapitre 18 : une intégration contrastée. In Héran, François. 2017. Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir. Paris : La Découverte : 287-295.
International Organisation of Employers. (2023). Analyse du climat des affaires dans les PMA : Haïti.https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=157992&token=8039a7742812799cd75aef62349e77170b929c3f Consulté en ligne le 06/01/2024.
Jacob, Sergot. (2020). Massification et financement public de l’enseignement supérieur en Haïti : Problèmes et défis. Revue Internationale des Sciences Administratives. 86(2) : 365-383.
Jacob, Sergot. (2023). Policy initiatives on the right to higher education in Haiti (Tracing Good and Emerging Practices on the Right to Higher Education). UNESCO IESALC.
Jamid, Hicham, Makki, Mohamed, et Merçon, Rony. 2021. Statut étudiant : regards croisés d’immigrés, Plein droit, 130(3) : 19-21.
Kabbanji, Lama, et Toma, Sorana. (2020). Politiques migratoires et sélectivité des migrations étudiantes en France : Une approche sociodémographique. Migrations Société. 180(2) : 37-64.
Kabbanji, Lama, Levatino, Antonina, et Toma, Sorana. (2021). Mobilités étudiantes internationales : L’attractivité de la France. Plein droit, 130(3) : 3-6.
Kapur, Devesh, et MacHale, John. (2005). Give us your best and brightest: The global hunt for talent and its impact on the developing world. Center for Global Development.
Li, Yong. (2020). Le paradoxe de la mobilité. Les évaluations subjectives des trajectoires postuniversitaires des diplômés chinois en France : Migrations Société. 180(2) : 97-112.
Mahut, David. (2017). Le déclassement dans la migration. Ethnographie d’une petite bourgeoisie bamakoise installée à Paris. Paris : L’Harmattan.
Malroux, Inès, Auriol-Desmulier, Élise, et Gosselin, Anne. (2023). Le déclassement professionnel parmi les immigrés en France : Une approche par méthodes mixtes (Working Paper du Ceped No 54). Centre Population et Développement. https://hal.science/ird-04056243 Consulté en ligne le 09/02/2024.
Meyer, J.-B. (2008). La circulation des compétences : un enjeu pour le développement. Annuaire suisse de politique de développement, 27(2) : 53-67.
Musselin, Christine. (2017). La grande course des universités. Paris : Presses de Sciences Po.
Organisation internationale pour les migrations (OIM). (2024, décembre). Rapport sur la situation de déplacement interne en Haïti — Round 9. https://dtm.iom.int/fr/reports/haiti-rapport-sur-la-situation-de-deplacement-interne-en-haiti-round-9-decembre-2024 Consulté en ligne le 9/05/2025.
Özden, Ç. (2005). Brain Drain in Latin America. International Mobility of Talent and Development Impact Project Meeting. Sponsored by UN, ECLAC and the World Institute of Development Economics Research. Santiago, Chile, 26-27 May.
Pinto Baleisan, Carolina. (2014). Se loger à Paris : L’expérience des étudiants étrangers. Hommes & Migrations. 1308 : 129-136.
Pons, Xavier. (2021). Le recours croissant aux enseignant·es contractuel·les : Vers un effet papillon ? Mouvements. 107(3) : 64-73.
Primo, Omane. (2024). Mobilité internationale étudiante et fuite des cerveaux : Le cas des étudiants haïtiens en France dans le contexte post-séisme de janvier 2010. Études caribéennes 59.
Van Zanten, Agnès. (2023). La marchandisation à l’œuvre dans le système scolaire et supérieur français : Raisons et conséquences. Administration & Éducation. 180 : 27-33.
Vincent, Marc-Donald, et Dona, Rochelyn. (2024). Les institutions d’enseignement supérieur reconnues en Haïti de 2018 à 2024 : Analyses statistiques, catégorisation géographique et perspectives. Revue Haïtienne des Sciences Sociales et Humaines. 1(6) : 101-120.
[1]Les autres catégories d’acteurs interrogés, au moyen d’entretiens semi-directifs, comprennent des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs haïtiens et français (ou francophones), des représentants d’organismes internationaux de coopération et de développement, ainsi que des acteurs politiques.
[2]Le Collège doctoral d’Haïti (CDH) regroupe actuellement trois écoles doctorales : l’École doctorale des sciences humaines et sociales de l’Université d’État d’Haïti (UEH), l’École doctorale « Société et Environnement » (EDSE) de l’Université Quisqueya (UniQ) et l’École doctorale en télécommunications de l’École Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH).
[3]Le dernier rapport du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) (2025 : 5) note « une recrudescence de la violence coordonnée des gangs visant sans discernement la population et les infrastructures critiques, dont l’aéroport et d’autres symboles de l’autorité de l’État dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans le département de l’Artibonite […] La capacité des gangs à mener des attaques au long cours durant plusieurs jours a progressivement augmenté, démontrant leur aptitude à se procurer de plus grandes quantités d’armes et de munitions et à étoffer leurs effectifs par l’enrôlement de mineurs ».
[4]En France, les bases de données nationales distinguent les « étudiants étrangers », définis comme ceux étudiant dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, et les « étudiants internationaux », qui n’ont pas de résidence permanente dans le pays d’accueil (Kabbanji et al., 2021 : 3). Cette dualité terminologique, source de défis majeurs pour l’étude de la mobilité étudiante, reflète également des enjeux politiques et institutionnels : comme le soulignent Erlich, Gérard et Mazzella (2021 : 53), la figure de l’« étudiant international » relève d’une stratégie de valorisation du prestige universitaire et d’attractivité de l’enseignement supérieur, tandis que celle de l’« étudiant étranger » s’inscrit dans une logique de maîtrise de l’immigration.
[5]Le plan « Stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux » a été présenté le 19 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe https://www.gouvernement.fr/partage/10704-presentation-de-la-strategie-d-attractivite-pour-les-etudiants-internationaux Consulté en ligne le 5/01/2020.
[6]Cette loi, adoptée par le Parlement (Sénat et Assemblée nationale) le 19 décembre 2023 et promulguée en janvier 2024, sera surnommée par la suite « loi Darmanin » en référence à Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur.Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 Consulté en ligne le 13/03/2024.
[7]Le niveau B2 correspond à un niveau avancé ou indépendant de la langue française selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) qui permet d’évaluer le niveau de maîtrise d’une langue étrangère. Selon ce cadre, les niveaux sont classés comme suit : A1 (niveau introductif ou de découverte), A2 (niveau élémentaire avancé), B1 (niveau seuil ou intermédiaire) ; B2 (niveau indépendant ou avancé), C1 (niveau autonome) et C2 (niveau de maîtrise correspondant à un utilisateur expérimenté). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739 Consulté en ligne le 18/02/2023.
[8]Le poste d’assistant d’éducation ou d’assistant pédagogique constitue une fonction d’appui au sein des établissements scolaires. Les AED interviennent en soutien à l’équipe éducative pour mener à bien diverses missions pédagogiques incluant la surveillance des élèves, l’aide aux devoirs et le soutien aux apprentissages. Présenté souvent comme un « job étudiant », ce contrat d’un an est renouvelable théoriquement jusqu’à cinq ans.
[9]La question de la naturalisation, dont les conditions se sont progressivement durcies (allongement des délais, tests de langue, etc.), mériterait une analyse spécifique qui dépasse le cadre de cette étude. Notre recherche n’aborde pas systématiquement le devenir professionnel des diplômés naturalisés, bien que cette piste puisse constituer un prolongement pertinent pour mesurer l’impact réel de la naturalisation sur l’intégration économique des diplômés haïtiens.
[10]Ce phénomène émergent de réorientation des diplômés haïtiens formés en France vers le Canada, perçu comme un espace plus attractif sur le plan socioprofessionnel, mérite néanmoins des recherches spécifiques afin d’en évaluer l’ampleur et d’en comprendre les modalités concrètes.