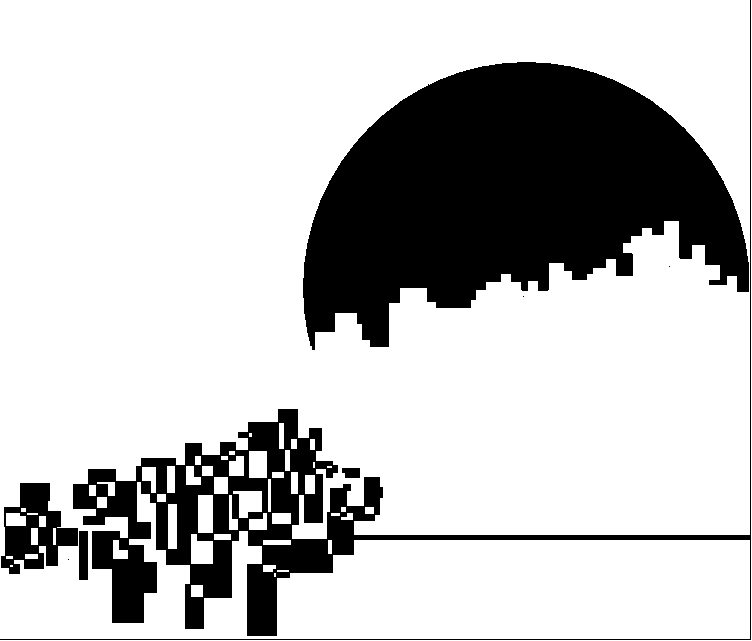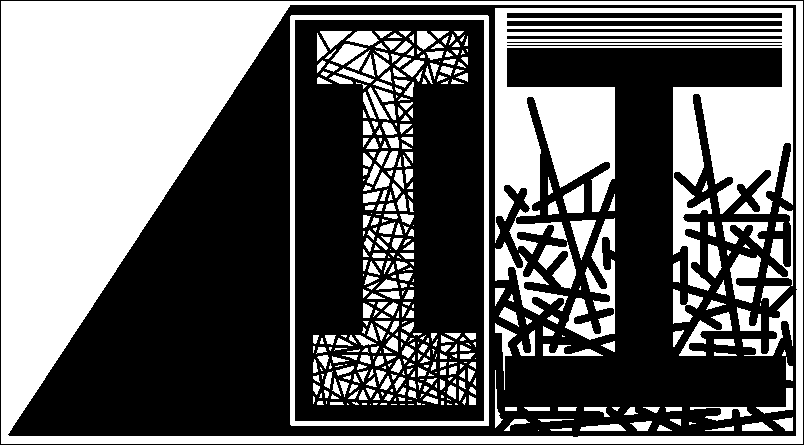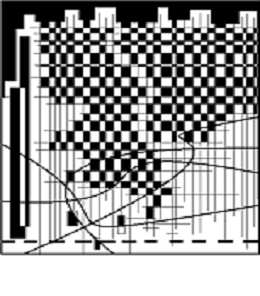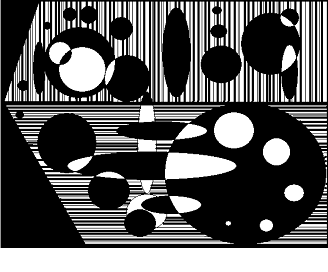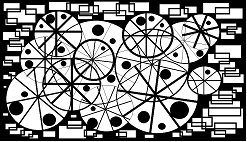Bilal Hamzetta : Ecole normale supérieure de Nouakchott, Nouakchott, hamzetta@yahoo.fr
Jérôme Ballet : UMR CNRS 5319 Passages, Université de Bordeaux, jballetfr@yahoo.fr
Introduction
Les enfants qui suivent un enseignement coranique traditionnel, les talibés, ont fait l’objet d’analyses multiples, notamment en Afrique de l’Ouest. La pratique de la mendicité à laquelle ils se livrent dans le cadre de leur éducation, en plus de l’apprentissage du Coran, a suscité de nombreuses controverses. Pratique d’apprentissage des vertus religieuses pour les uns (Hamzetta, 2006), mendicité forcée pour les autres (Zoumanigui, 2016), elle interroge la conception universaliste des droits de l’enfant et de l’éducation (Ndiaye, 2015). Selon Macleod (2023), il faudrait cependant distinguer les enfants qui mendient sans apprendre le Coran et ceux qui connaissent un vrai apprentissage religieux. Les premiers ne devraient pas à proprement parlé être considérés comme des talibés. Il faut également distinguer les enfants qui suivent un enseignement dans les daaras (Dia et al., 2016) et ceux qui intègrent des merdersas (Bouhlel Hardy, 2010 ; Gérard, 1997). Les premières se limitent à l’apprentissage du Coran et adoptent souvent la pratique de la mendicité, tandis que les secondes combinent scolarisation coranique et enseignements multiples, sans faire usage de la mendicité. Les daaras représentent l’enseignement traditionnel et les medersas l’enseignement moderne, bien qu’une telle distinction soit sujet à caution en raison des politiques de modernisation des daaras que certains pays ont mis en œuvre (D’Aoust, 2013). C’est, toutefois, sur les enfants placés dans des daaras que nous nous focalisons.
Dans ces « écoles », l’enseignement traditionnel n’a pas tant pour objet de fournir une capacité de compréhension et de raisonnement que de participer à un processus de socialisation des enfants (Eickelman, 1978). L’entrée dans une daara n’est pas perçue par les populations musulmanes d’Afrique de l’Ouest comme un moyen d’acquérir des connaissances, mais plutôt comme une obligation religieuse (Loimeier, 2002). Être un bon musulman suppose d’avoir suivi un enseignement religieux sous la houlette d’un maître aussi appelé Sheikh ou marabout. L’enseignement traditionnel dans les daaras s’étend sur plusieurs années, voire la vie entière, et comporte des phases très précises d’apprentissage. Le maître prend l’entière responsabilité de l’enfant et de son éducation, en enlevant la charge aux parents. En échange de cette prise en charge, il exige un paiement qui peut prendre la forme d’un versement en argent ou en nature (nourriture principalement mais aussi animaux dans certains cas) effectué par les parents et d’un revenu obtenu par l’enfant grâce à une activité de mendicité. En l’absence de paiements réguliers réalisés par les parents, du fait de leur pauvreté (Balde, 2010), la pression s’accentue sur les enfants et leur mendicité devient le seul revenu pour le maître. La violence des maîtres coraniques envers les enfants afin de les contraindre à gagner suffisamment a ainsi été largement documentée (Ballet et al., 2012, 2019 ; Boutin, 2019 ; Ndiaye, 2015). Toutefois, une bonne partie de ces analyses relèvent d’un rapport éducatif interindividuel entre maître et enfant hors contexte économico-spatial. Les analyses statistiques sur les violences envers les enfants et les jeunes, menées dans 26 pays dans le monde[1] soulignent d’ailleurs la prévalence très forte de la violence dans les systèmes éducatifs. Pour comprendre la spécificité des violences que subissent les enfants talibés, il faut cependant élargir le spectre de l’analyse en portant un regard sur le cadre économique et spatial dans lequel se déroule cet enseignement traditionnel. Tine et al. (2020) ont déjà souligné que la mendicité des enfants de ces écoles doit être analysée dans une logique spatiale.
Ce travail envisage de dépasser leur analyse en montrant que la concentration des daaras dans les centres urbains crée un espace de concurrence pour la mendicité, qui accroît le risque de violence, et ce de deux manières au moins. D’une part, parce que sur un territoire donné l’accroissement du nombre d’enfants mendiants réduit, toutes choses égales par ailleurs, la possibilité de collecter un revenu important pour chaque enfant, ce qui en retour peut se répercuter par des sanctions violentes des marabouts à l’encontre des enfants. D’autre part, parce que la concentration et la concurrence des enfants sur un même territoire provoquent des confrontations entre groupes d’enfants talibés pour l’accès aux zones propices à la mendicité, ce qui peut tourner dans un bon nombre de cas à des actes de violence entre enfants. Il s’agit en somme d’analyser le rapport à l’espace de ces enfants à l’aune de l’accroissement de la concurrence et d’en analyser les effets en termes de violence sur et entre les enfants.
Notre analyse repose sur une enquête de terrain menée en Mauritanie. Cette enquête a porté sur des enfants talibés de la ville de Nouakchott et sur des maîtres de cette même ville. Dans une première section nous présentons la méthodologie de l’enquête. Nous présentons ensuite, dans une seconde section, les caractéristiques générales des enfants talibés et des marabouts enquêtés. Dans une troisième section, nous développons la relation entre concurrence et violence dans l’enseignement traditionnel. Puis, en quatrième section, nous concluons sur l’importance des politiques de régulation des daaras.
I Contexte et méthodologie de l’enquête
Nous distinguons la méthodologie d’enquête auprès des enfants et auprès des maîtres.
1. Méthodologie de l’enquête auprès des enfants.
L’enquête a porté sur 116 enfants dans la ville de Nouakchott. Ils ont été rencontrés dans la rue, leur lieu de mendicité. Il n’est en effet pas difficile de reconnaître les enfants talibés en raison de leur activité de mendicité généralement réalisée avec une boîte de conserve (ce qui leur confère généralement un signe distinctif par rapport aux autres mendiants). Compte tenu de la sensibilité du sujet, il paraissait extrêmement délicat de les rencontrer dans les daaras en présence du marabout. L’enquête dans la rue a permis aux enfants de s’exprimer plus librement puisqu’à l’écart de la surveillance du maître.
Les zones d’enquêtes ont été multiples. Pour éviter un éventuel biais lié à la localisation dans un quartier, par exemple un quartier riche ou un quartier pauvre, nous avons eu recours à une méthodologie d’enquête aléatoire à travers la ville, par approche des enfants sur les lieux de mendicité ; l’enquête porte ainsi aussi bien sur des enfants rencontrés dans les quartiers du centre ville que des quartiers plus excentrés. Si les enfants se déplacent pour mendier, de nombreux endroits stratégiques permettent de les rencontrer aisément : sortie des mosquées, feux de circulation, abords de l’hôpital, galeries commerçantes, marchés, etc.
L’enquête que nous avons menée est à la fois quantitative et qualitative. Nous avions des questions fermées et précises telle que « Te bas tu souvent avec d’autres enfants dans la rue ? » et des questions ouvertes du type « comment se passent les relations avec les autres enfants dans la rue ? ». Il nous a ainsi été possible de recouper les informations obtenues à partir de questions fermées avec des informations provenant de questions plus ouvertes qui exigeaient souvent une discussion plus longue avec les enfants. Cherchant à nous focaliser sur la violence physique nous n’avons pas intégré des distinctions plus subtiles sur la violence morale et psychologique. L’enjeu essentiel était pour nous d’établir l’existence de relations violentes physiquement entre les différents groupes d’enfants talibés.
Par ailleurs, cette enquête a été menée sur une période relativement courte afin que le bruit que nous menions une enquête ne se diffuse pas, ce qui explique la faible taille de l’échantillon. Etant donnée la sensibilité du sujet, si les maîtres avaient eu vent de cette enquête, il est fort probable que des « consignes » auraient été données aux enfants sur les réponses à nous fournir. Et des représailles sur ces derniers auraient pu se produire. Dans ces conditions, nous avons préféré réduire notre enquête à un échantillon modeste.
2. Méthodologie de l’enquête auprès des maîtres
Le volet « maître » de l’enquête a porté sur 37 marabouts de cette même ville. Il a été mené simultanément à celui des enfants, sans que les marabouts ne sachent que nous menions un volet de l’enquête simultanément auprès de ceux-ci. Les marabouts enquêtés l’ont également été de manière à avoir une répartition géographique dans la ville. Nous n’avons cependant pas cherché à respecter une représentativité exacte de la répartition des daaras dans la ville parce que cette répartition n’est pas connue avec exactitude, y compris par les autorités du pays. Les daaras sont en effet difficilement identifiables. Il s’agit parfois d’un simple hangar ou un garage anonyme qui sert d’école, et il est possible de passer devant sans le savoir. Pour cette raison, nous avons opté pour une solution consistant à demander aux talibés que nous interrogions de nous indiquer les lieux des daaras. Nous avons plutôt privilégié les quartiers populaires dans la mesure où les daaras y sont plus nombreuses (cf. tableau 1).
Tableau 1. Répartition des marabouts enquêtés par quartiers
| Quartiers | Nombre |
| Arafat | 3 |
| Basra | 3 |
| Capitale | 2 |
| El-mina | 8 |
| Ksar | 1 |
| Marbat | 1 |
| Médina | 8 |
| Sebkha | 8 |
| Socogim | 3 |
| Total | 37 |
Nous avons rencontré les marabouts sur les lieux d’exercice, c’est-à-dire dans les daaras. Nous avons là aussi utilisé un questionnaire avec des questions précises et fermées et des questions ouvertes qui permettaient de recouper les informations quantitatives et qualitatives. Lors de ces entretiens nous n’avons pas posé de questions relatives à la violence. Nous pouvions en effet anticiper que nous trouverions une forte résistance de la plupart des maîtres qui, au lieu de répondre à notre questionnaire, auraient fait front contre toute l’enquête elle-même. À travers les questions, nous avons plutôt cherché à collecter des informations concernant, d’une part leur sentiment à l’égard du développement des daaras, d’autre part des informations sur les conditions d’exercice de leur profession, dans lesquelles nous avons glissé des questions concernant les consignes qu’ils donnaient aux enfants pour exercer leur activité dans la rue.
Le recoupement du sentiment des maîtres à l’égard de leur profession, des réponses fournies par les enfants talibés et l’observation de terrain nous ont servi à bâtir notre analyse.
II Caractéristiques générales des enfants et des marabouts enquêtés
Comme pour la méthodologie, nous présentons d’abord les caractéristiques des enfants, puis celles de maîtres.
1. Caractéristiques générales des enfants enquêtés.
Sur les 116 enfants enquêtés, nous avons recensé seulement une fille. Le phénomène des enfants talibés est en fait essentiellement masculin. Les filles ne sont quasiment pas présentes dans les daaras. Le caractère religieux de l’enseignement et le fait que les maîtres soient exclusivement des hommes, expliquent largement l’absence de filles. Le placement dans des daaras concerne de fait quasiment que des garçons puisqu’un des objectifs est que les disciples deviennent à leur tour des marabouts ou des Imam de Mosquée ou encore des Cadi (juges).
En moyenne, les enfants talibés sont dans l’école depuis 3 ans et demi. La moyenne d’âge des enfants est de 12,68 ans. Ils sont parfois confiés aux marabouts dès leur jeune enfance (à partir de 5 ans) et ils peuvent rester avec le marabout jusqu’à l’âge adulte[2].
La majorité des enfants talibés sont de l’ethnie Haal Puular, 74,2%. Les enfants des autres ethnies sont marginalement représentés. Cependant, 18,9% des enfants disent ne pas connaître leur ethnie d’appartenance. Ceci peut s’expliquer si les enfants ont été confiés dès leur jeune âge. Mais surtout les enfants n’ont pas une idée précise de ce qu’est une appartenance ethnique, puisqu’une partie de ceux qui n’ont pu répondre à cette question ont évoqué le métier de leur père ou la caste d’appartenance reliée au métier exercé par leur père.
La très forte proportion d’enfants issus de l’ethnie Haal Puular n’est guère étonnante et ce pour deux raisons. D’une part, il s’agit d’une ethnie à tendance très fortement musulmane et dont les activités économiques sont fortement orientées vers l’élevage et l’agriculture. Une bonne partie des Haal Puular continue de pratiquer un élevage transhumant, avec un mode de vie encore semi-nomade. De ce fait, les enfants sont aisément confiés à un marabout pour leur éducation.
D’autre part, le Grand ALmamy et Prédicateur de L’islam El hadj Omar Tall est le fondateur des écoles coraniques Haal Puular dans le pays. Il est lui-même Haal Puular et son style a largement imprégné le système d’enseignement coranique traditionnel. Ainsi si l’ethnie Haal Puular n’est pas l’ethnie majoritaire du pays, elle est néanmoins fortement présente dans les écoles coraniques traditionnelles[3].
2. Caractéristiques générales des maîtres enquêtés.
Même si le nombre de maîtres que nous avons enquêté est insuffisant pour en tirer des résultats représentatifs, le tableau 2 indique qu’un bon nombre s’est installé récemment, moins de 5 ans pour près d’un tiers d’entre eux. Les témoignages de maîtres enquêtés relèvent aussi que la profession est sujette à des entrées et sorties récurrentes, soulignant à cette occasion la moindre professionnalisation et une tendance au rajeunissement.
Tableau 2. Nombre d’enfants accueillis selon le nombre d’années dans la profession
| Nombre d’années dans de la profession | |||||||
| Nombre d’enfants accueillis | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | + de 20 | Total | |
| – de 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 20-40 | 7 | 1 | 5 | 13 | |||
| 40-60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| + de 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| Total | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 37 | |
Il faut noter qu’un effet de notoriété et d’accumulation des enfants talibés semble se produire avec l’ancienneté dans la profession. Les maîtres exerçant depuis plus longtemps sont ceux qui ont le plus d’enfants en charge (tableau 2).
III Concurrence et violence
Afin d’établir que la concurrence joue dans le risque de violence que subissent les enfants talibés, nous développons deux aspects. Premièrement, la concurrence entre enfants dans la collecte de la mendicité réduit potentiellement le gain de chaque enfant, ce qui toutes choses égales par ailleurs, peut impliquer des sanctions violentes de la part des maîtres à l’égard des enfants. Or, ce phénomène sera d’autant plus conséquent que le nombre de daaras augmente. Deuxièmement, la concurrence entre enfants talibés sur les lieux de mendicité peut donner lieu à des confrontations entre groupes ou entre certains enfants qui conduisent parfois à des actes de violence.
1. Concurrence entre maîtres et pression sur les enfants
Avant d’en venir au phénomène de concurrence, nous soulignons quelques mutations majeures de l’enseignement traditionnel coranique. L’enseignement coranique traditionnel a connu des modifications significatives avec la colonisation (Panait, 2021). Et le processus de transformation s’est poursuivi après les indépendances. Selon Cruise O’Brien (1970), tant que les écoles coraniques se situaient en zones rurales la soumission des talibés à leur maître s’accompagnait du principe du don libre au maître sous forme de travail ou d’argent qui permettait à ce dernier de vivre de son activité de guide spirituel. Les talibés étaient ainsi souvent amenés à travailler sur des parcelles de terres possédées par le maître. Le principe de don libre s’est cependant vite transformé en « taxation religieuse » face aux mutations de l’économie et l’entrée dans une économie de marché. Les maîtres ont instauré un système de paiement forcé. L’urbanisation a renforcé ce phénomène. Le fait que les maîtres eux-mêmes se trouvent en ville a engendré la venue d’une nouvelle forme d’activité pour les disciples : la mendicité. Les revenus de la mendicité collectés par les disciples sont apparus comme une composante essentielle du revenu du maître.
Depuis les années 1980, la tendance à l’exode rural et à l’urbanisation des pays d’Afrique de l’Ouest a favorisé une relocalisation des écoles coraniques dans les centres urbains et leur disparition progressive en zones rurales (Sanankoua, 1985, Loimeier, 2002). Leur relocalisation dans les centres urbains s’est accompagnée d’une « disqualification sociale », faisant des daaras des écoles coraniques pour les pauvres.
En effet, d’une part la montée en puissance de l’éducation publique, malgré toutes ses défaillances, avec parfois une visée explicite de réduire le rôle des maîtres coraniques, a diminué en grande partie l’attrait des classes sociales les plus aisées pour les écoles coraniques. Sanankoua (1985) constate, dans le cas du Mali, que les enfants placés dans les daaras sont essentiellement issus de classes sociales modestes. Tandis que les classes sociales les plus favorisées désertent ces écoles, le contexte de pauvreté grimpante qu’ont connu les pays d’Afrique de l’Ouest dans les années 1980 a incité les parents modestes à placer leurs enfants dans les daaras en zones urbaines (Perry, 2004).
D’autre part, les mouvements réformateurs musulmans ont œuvré pour un rapprochement des enseignements dispensés dans les écoles arabes et les écoles publiques (Loimeier, 2002). Les medersas, écoles musulmanes dans lesquelles les maîtres dispensent des enseignements de mathématiques, de français, d’histoire, de géographie, etc., en plus du Coran, sont venues concurrencer directement les écoles coraniques traditionnelles. Les medersas présentent deux caractéristiques importantes par rapport aux écoles coraniques traditionnelles : tout d’abord, elles adoptent un mode et un rythme de scolarisation identiques aux écoles publiques (outre le fait qu’elles se calent généralement sur les enseignements des écoles publiques, elles suivent aussi le même rythme : récréation, vacances scolaires, et les enfants ne sont pas placés mais y viennent pour la journée). Au contraire les écoles coraniques traditionnelles dispensent pour l’essentiel l’enseignement du Coran et rien d’autre, et par ailleurs les enfants y sont généralement placés à l’année avec des vacances exclusivement lors des fêtes musulmanes. Ensuite, les medersas profitent de subventions des pays du Moyen Orient qui, de la sorte, accroissent leur influence en Afrique, alors que les écoles coraniques traditionnelles ne bénéficient généralement d’aucune aide de la sorte. Les daaras sont non seulement des écoles coraniques pour les pauvres, mais aussi des écoles pauvres. D’ailleurs, souvent les daaras ne sont pas des écoles à proprement parler. Il n’y a pas de salle de classe. Les enfants sont généralement accueillis dans la maison du maître et ils dorment souvent dans la cour ou une pièce servant de dortoir. L’apprentissage du Coran se poursuit dans une des pièces de la maison, ou parfois à l’air libre dans la cour, ou tout simplement sous un arbre. Le fait que les daaras soient des écoles pauvres pour les pauvres ne saurait cependant suffire pour expliquer la violence. Tout au plus, il permet de comprendre que la mendicité soit devenue un moyen central de l’éducation dans ces écoles, et qu’une pression sur les gains collectés par ce biais s’exerce.
Pour comprendre la violence, il faut tenir compte de la dynamique des sorties des daaras dans le temps. Bien qu’aucune statistique sur le sujet n’existe, il est possible d’émettre l’hypothèse que les jeunes formés dans ces écoles n’aient guère d’autre perspective que de créer eux-mêmes une telle école. Leur niveau de formation générale est en effet très insuffisant pour qu’ils accèdent au marché du travail. Ballet et al. (2020), à partir de leur analyse sur la Mauritanie, soulignent d’ailleurs que les talibés aspirent très majoritairement à devenir maître à leur tour. Normalement, avant de s’installer comme maître, l’étudiant talibé doit avoir achevé sa formation. Dans la pratique, de nombreux étudiants talibés s’installent avant même d’avoir fini leur cursus coranique. Dans la mesure où la validation du cursus n’est elle-même pas établie par un acte national officiel, mais par la simple validation du maître ayant enseigné, de nombreux étudiants deviennent maître avant d’avoir franchi toutes les étapes. Dans un contexte marqué par des difficultés d’accès au marché du travail, la pression pour l’installation des jeunes devient plus forte et tend à provoquer un rajeunissement de la profession. Ce rajeunissement devient lui-même un mécanisme d’accroissement de la concurrence entre écoles coraniques. La régulation par la durée de l’enseignement se restreignant, l’entrée de marabouts plus jeunes accroît la concurrence entre écoles. Nos entretiens avec les marabouts en Mauritanie ont confirmé qu’aucune règle n’existait en matière de création de daaras et que l’installation était parfaitement libre. Lafdal et H’Meyada (2001) notaient, il y a plus de vingt ans, que le nombre de daaras ne cessait d’augmenter.
La dynamique des daaras entretient un mécanisme pervers dans la mesure où les jeunes formés n’ont guère d’autres perspectives que de devenir maître, où le temps d’apprentissage se réduit et facilite le rajeunissement des maîtres qui concurrencent leurs anciens maîtres et leurs camarades. Les daaras étant principalement intégrées par des pauvres et la mendicité la principale ressource, la violence envers les enfants pour qu’ils gagnent assez d’argent peut devenir un moyen de pression. Les marabouts les plus jeunes en particulier, dont la réputation n’est pas établie, peuvent être poussés à pratiquer des sanctions violentes à l’encontre des talibés ne ramenant pas assez d’argent dans la mesure où l’argent collecté par ces derniers constitue la rémunération des premiers. Le fait que les actes de violence relevés dans la presse et perpétrés par les marabouts concernent pour l’essentiel des marabouts jeunes pourrait ainsi trouver une explication dans la logique de survie des marabouts dans un contexte fortement concurrentiel.
22 des 37 marabouts interrogés ont déclaré qu’il y avait bien concurrence entre eux, et la plupart souligne que cette concurrence est très forte. Cependant, ils précisent généralement que cette concurrence est d’ordre spirituel. Il s’agit d’attirer le plus possible les enfants par leur notoriété dans la mesure où le nombre d’enfants dans l’école est à la fois un signe de prestige mais aussi un moyen de collecter de l’argent. Il est à noter que les marabouts se sont montrés très peu loquaces dès que les questions d’argent étaient abordées. Cependant, certains ont bien affirmé que la concurrence spirituelle était aussi une concurrence économique.
Cet état de fait plaide en faveur de notre hypothèse selon laquelle la concurrence accroît le risque de violence. En effet, l’augmentation du nombre d’écoles diminue, toutes choses égales par ailleurs, les gains potentiels des maîtres, ce qui se répercute par des sanctions violentes sur les enfants. Parmi les enfants enquêtés, 50,9% d’entre eux ont déclaré avoir déjà été battus par leur maître. Ils avancent deux raisons à ces violences : d’une part le fait qu’ils n’aient pas ramené assez d’argent avec leur activité de mendicité, puisque le maître prélève une bonne partie des gains déclarés par les enfants, ce que confirment d’autres études (UN office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2004); d’autre part ils ont reçu des coups à la suite de leçons mal apprises ou de récitations mal prononcées.
2. Concurrence entre talibés et violence
De fait, l’activité de mendicité structure la relation des enfants talibés à l’espace. Les enfants que nous avons interrogés perçoivent leur journée dans un rapport permanent aux endroits où ils peuvent collecter de l’argent. Hormis la pression exercée par les maîtres par la violence physique, il faut noter que 87,1% des enfants déclarent que les maîtres ne fournissent pas de repas. Ils mangent grâce aux subsides gagnés par la mendicité. De nombreuses offrandes en nature sont également faites aux enfants talibés (sucre, riz, etc.) et certains « restaurants » ou échoppes marchandes leur offrent parfois de la nourriture. En somme, ils se débrouillent généralement pour manger. La plupart d’entre eux a d’ailleurs déclaré manger à n’importe quel moment, en fait dès qu’ils collectent à manger, et ne pas avoir d’heure de repas. La ville est avant tout un ensemble de lieux de collecte de gains monétaires ou en nature.
Or seulement 19,8% des enfants interrogés ont déclaré avoir reçu des consignes de leur maître sur la zone où ils doivent exercer leur mendicité. Les autres déclarent choisirent eux-mêmes ces zones. L’enquête menée auprès des maîtres confirme cet état de fait. Sur les 37 marabouts enquêtés, seulement 7 ont dit donner des indications aux enfants sur les lieux de mendicité. Les zones les plus attrayantes du territoire apparaissent alors comme un objet de convoitise pour les différents groupes d’enfants. Si beaucoup d’entre eux ne sont pas fixes durant toute la période de mendicité et se déplacent d’une zone à l’autre, les rencontres d’autres groupes sur des zones à fort potentiel de gains peuvent provoquer des conflits donnant parfois lieu à des violences entre enfants. La multiplication des daaras génère ainsi une concurrence entre groupes favorisant le risque de violence.
Les feux de circulation, les entrées de mosquées, les zones commerçantes, etc., constituent des endroits stratégiques où les groupes d’enfants peuvent se rencontrer. Si les zones stratégiques sont multiples, la concurrence entre enfants se joue aussi sur le territoire pour l’accès aux meilleures zones. Lors de notre enquête, nous avons interrogé les enfants sur les rivalités entre groupes et sur les relations avec les autres groupes d’enfants talibés. Il ressort de l’enquête que les relations avec les autres groupes d’enfants talibés sont mitigées. 43% déclarent qu’elles sont bonnes tandis qu’inversement 57% déclarent qu’elles sont mauvaises et que des conflits sur les zones de mendicité ont régulièrement lieu. Ces conflits donnent parfois lieu à des violences entre enfants. La pression qu’exercent les maîtres joue dans le degré de violence entre groupes enfants puisqu’il faut ramener son dû en fin de journée pour ne pas subir de représailles. Dans de telles conditions, la ville devient un espace de confrontation dans lequel les lieux les plus rentables sont des sources de discorde entre groupes. La dispersion sur les différents lieux est elle-même réduite puisqu’elle dépend de facteurs temporels. Aux heures d’affluence sur les routes, les feux de circulation constituent les endroits stratégiques ; les vendredis les mosquées sont des points de ralliement ; les marchés sont aussi des endroits privilégiés les jours où leur activité est importante ; en fin de mois les sorties des banques où les employés viennent chercher leur paye sont la cible de nombreux enfants, etc. La ville est vécue par ces enfants comme un ensemble de lieux de gains potentiels dont la localisation est dépendante du moment de la journée et du jour. En même temps, ces lieux sont la source de confrontations parfois violentes que la concurrence entre maîtres ne fait qu’accentuer.
Conclusion
Les risques de violence que subissent les enfants talibés sont étroitement liés à la concurrence que se livrent les daaras. Le rajeunissement des marabouts atteste de la montée en puissance du nombre d’écoles, et toutes choses égales par ailleurs, la concurrence entre les écoles exacerbe la violence.
Il est loin d’être aisé de remédier à ce phénomène. Cependant différentes pistes peuvent être explorées. Lafdal et H’Meyada (2001) concluaient, dans un rapport établi pour le compte de l’UNICEF en Mauritanie, que la solution consistait pour l’État à prendre en charge la rémunération des maîtres. Cette solution nous paraît peu adéquate dans la mesure où la prolifération des écoles conduirait surtout à une forte pression financière sur l’État. Et ce d’autant plus que la garantie d’un revenu pourrait inciter de nombreux prétendants à se déclarer comme marabout.
Si, comme nous l’avons discuté dans cet article, le risque de violence est fortement lié à la concurrence entre les daaras, une régulation du nombre d’écoles s’avèrerait plus efficace pour faire diminuer les risques de violence. En particulier, alors que la libre installation est actuellement la règle, il conviendrait peut-être de réguler leur ouverture. Deux systèmes sont envisageables de ce point de vue. Tout d’abord, la régulation peut se réaliser par la définition de quotas d’ouverture par an en fonction de la pression démographique. Ensuite, une régulation pourrait avoir lieu par la reconnaissance d’une qualification nationale des maîtres, évitant ainsi l’implantation d’écoles dirigées par de « trop jeunes » marabouts. Mais une telle solution supposerait également la définition au niveau national d’une politique de validation des acquis des écoles coraniques, là où actuellement seul le maître fait autorité.
Présentation des auteurs :
Bilal Hamzetta est Professeur à l’Ecole normale supérieure de Nouakchott. Ses recherches portent sur la pauvreté et le développement. Il a publié notamment l’ouvrage Formes sociales de la pauvreté en Mauritanie (L’Harmattan).
Jérôme Ballet est enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux. Ses recherches portent sur les questions d’éthique appliquée à l’économie, dont le travail et la pauvreté des enfants. Il a publié ou édité plus d’une vingtaine d’ouvrages, dont Freedom, responsibility and economics of the person (Routledge), et L’économie à l’épreuve de l’éthique (De Boeck supérieur).
Références
Balde, Aua. (2010). The Case of Talibé Children–Unveiling One of the Faces of West-African Poverty. European Development Report.
Ballet, Jérôme, Bhukuth, Augendra, Hamzetta, Bilal, & Vos, Robin. (2020). “Education and aspirations in a capability-based approach: the case of talibé children in Mauritania”. International Journal of Education Economics and Development. Vol 11(2):113-131.
Ballet, Jérôme, Bhukuth, Augendra, & Hamzetta, Bilal. (2019). “The exploitation of Talibé children in Mauritania”. In Ballet J. & Bhukuth A. (eds), Child Exploitation in the Global South. New York: Palgrave-McMillan: 93-107.
Ballet, Jérôme, Bhukuth, Augendra, Hamzetta, Bilal. (2012). « Vulnerability to violence of Talibé children in Mauritania ». Child Abuse & Neglect. N° 36: 602-607.
Bouhlel Hardy, Ferdaous. (2010). Les médersas du Mali: réforme, insertion et transnationalisation du savoir islamique. Politique étrangère. N° 4: 819-830.
Boutin, Delphine. (2019). “A Portrait of Koranic School Students in the Dakar Region”. In Ballet J. et Bhukuth A. (eds), Child Exploitation in the Global South. New York: Palgrave-McMillan: 109-123.
Cruise O’Brien, Donal. (1970). The Mourides of Senegal : The Political and Economic Organization of an Islamic Brotherhood. Oxford: Oxford University Press.
D’Aoust, Sophie. (2013). « Écoles franco-arabes publiques et daaras modernes au Sénégal: hybridation des ordres normatifs concernant l’éducation ». Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs. N° 12 : 313-338.
Dia, Hamidou, Hugon, Clothilde, d’Aiglepierre, Rohen, & Stout, Claire. (2016). “Senegalese Qur’anic school systems”. Afrique contemporaine. N° 257(1):106-110.
Eickelman, Dale. F. (1978). « The art of memory: Islamic education and its social reproduction ». Comparative Studies in Society and History. N° 20(4): 485-516.
Hamzetta, Bilal. (2006). « Responsabilité, handicaps, accidents et opportunités sociales en Mauritanie ». Ethique et Economique/Ethics and Economics. Vol 2(2) : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3315
Lafdal, Mohamed., H’Meyada, Mohamed. (2001). Etude sur la situation des enfants talibés mendiants (almoude) en Mauritanie. UNICEF-Direction de l’Action Sociale, mimographe, Nouakchott.
Loimeier, Roman. (2002). « Je veux étudier sans mendier. The Campaign Against the Quranic Schools in Senegal ». In H. Weiss (ed), Social Welfare in Muslim Societies in Africa. Nordiska Afrikainstitutet : 116-134.
Gérard, Étienne. (1997). « Les médersas: un élément de mutation des sociétés ouest-africaines ». Politique étrangère. Vol 62(4): 613-627.
Macleod, Shona. L. (2023). “There are talibés and talibés”: Exploring the boundaries of the category of talibés who beg. Child Abuse & Neglect. N° 139: art.105422 : 1-9.
Ndiaye, Papa Oumar. (2015). « Aumône et mendicité: un autre regard sur la question des talibé au Sénégal ». Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs. N° 14 : 295-310.
Panait, Oana Marina. (2021). Daaras et talibés: Construction d’un problème public après le XIXe siècle: la mendicité des talibés. Louvain-la-Neuve: EME éditions.
Perry, Donna L. (2004). « Muslim Child Disciples, Global Civil Society, and Children’s Rights in Senegal: The Discourses of Strategic Structuralism ». Anthropological Quarterly. Vol 77(1): 47-86.
Sanankoua, Diarah Bintou. (1985). « Les écoles coraniques au Mali ». Revue Canadienne des Etudes Africaines. Vol 19(2) : 359-367.
Saul, Mahir. (1984). « The Quranic School Farm and Child labour in Upper Volta ». Africa. Vol 54(2): 71-87.
Tine, Benoit, Diallo, Mamadou Aguibou, & Dione, Ibrahima D. (2020). « Dynamique socio spatiale de la mendicité des talibés dans la commune de Ziguinchor (Sénégal) ». Echanges, N°14 : 483-505.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2004). Kids begs for hour to fund Muslim teachers. May 24, http://www.irinnews.org/print.asp?ReportID=4121.
Zoumanigui, Antoinette K. (2016). “On the Talibé phenomenon: A look into the complex nature of forced child begging in Senegal”. The International Journal of Children’s Rights. Vol 24(1) : 185-203.
[1] (https://www.togetherforgirls.org/en/about-the-vacs)
[2] Saul (1984) notait dans le cas du Burkina Faso que l’enseignement durait en moyenne 9 ans. Il peut cependant s’étendre sur une période beaucoup plus longue encore.
[3] En Mauritanie il y a quatre ethnies musulmanes qui sont différentes par leur langue, leur culture, leur civilisation et leur nombre. L’ethnie Maure, la plus nombreuse, est constituée par les descendants des Arabo-berbères et des Haratines qui partagent la même langue, la même culture et la même civilisation. Les enfants issus de cette ethnie ne font que rarement la mendicité, car leur système d’enseignement coranique n’institue pas la demande de l’aumône comme partie intégrante du cursus de formation, et celui-ci n’a guère été altéré par les nouvelles conditions économiques récentes. L’ethnie Haal Puular vient en deuxième position du point de vue nombre ; les enfants talibés que nous avons rencontrés sont essentiellement originaires de cette ethnie. Les autres ethnies sont constituées des Soninkés et des Wolofs. On peut certes rencontrer des enfants talibés issus de ces ethnies, mais ils sont moins nombreux que les autres.