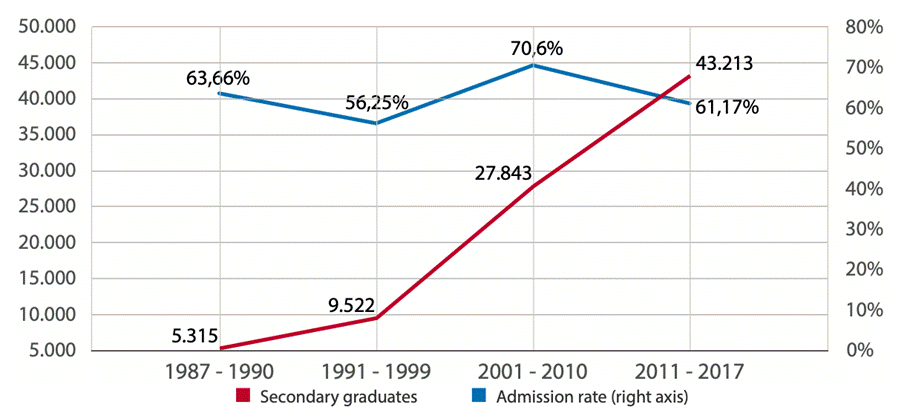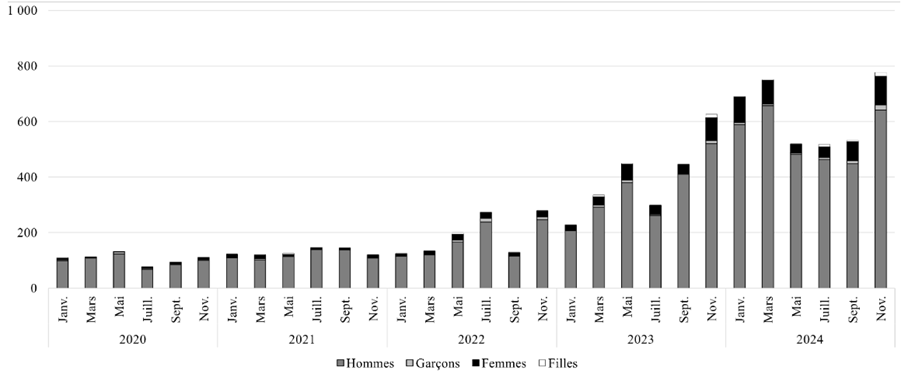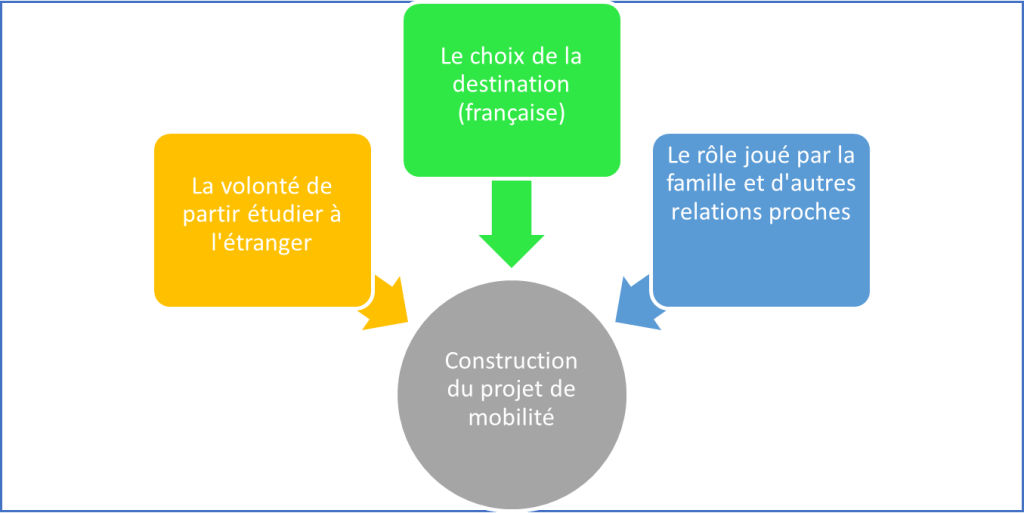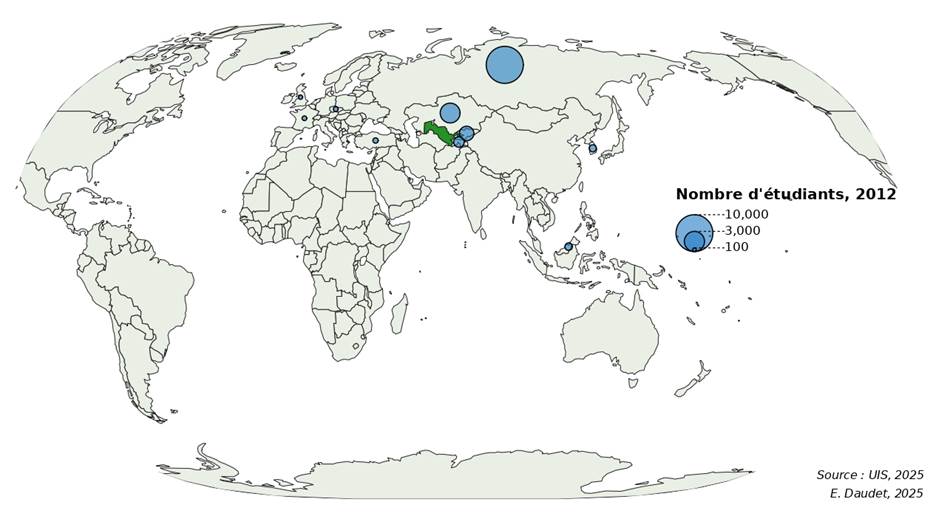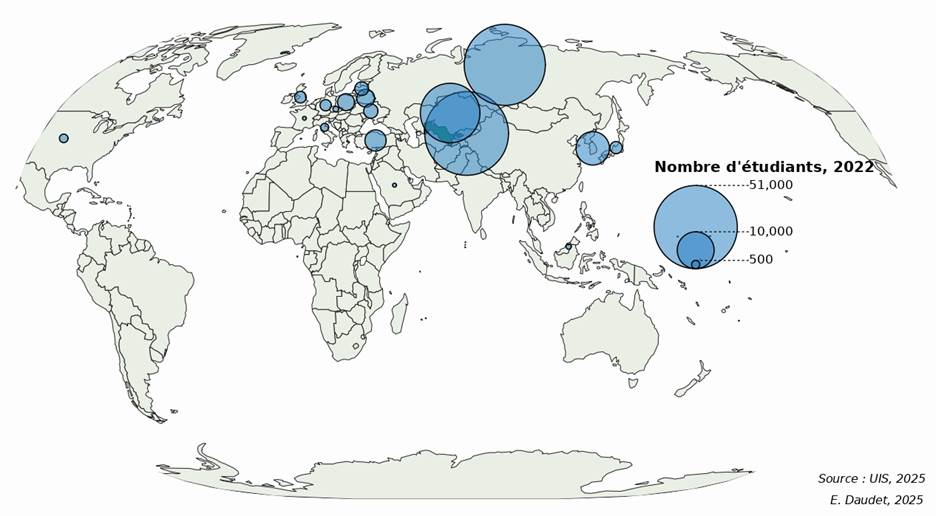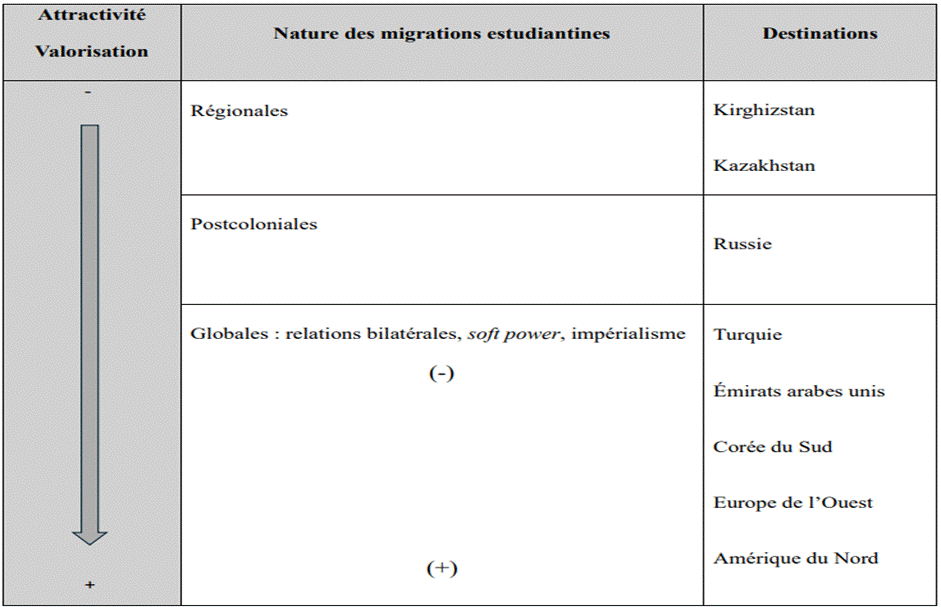Nous publions l’interview croisée de deux étudiants en migration internationale invités à décrire leur parcours de mobilité.
Ces récits sont des témoignages de situations vécues dans des contextes sociaux, académiques et familiaux particuliers. Leur ambition n’est pas de représenter toutes les situations que peuvent rencontrer les étudiants et les étudiantes en mobilité internationale, mais de donner à voir les multiples facteurs qui entourent et modèlent certaines migrations. Ces témoignages mettent en lumière les influences des nombreux acteurs qui y contribuent -ou les freinent- et les différents types de ressources mobilisées.
Face aux récits de vie, on gardera à l’esprit certains écueils possibles, notamment la tendance des individus à rationaliser ou à recomposer leurs parcours. Mais on verra que ceux-ci sont loin de masquer les difficultés, les hésitations, les tensions qui ont jalonné les projets.
Afin de mieux comprendre les parcours évoqués, il est sans doute utile d’avoir à l’esprit quelques repères sur les démarches que doit effectuer un·e étudiant.e extra-européen·ne souhaitant suivre des études en France.
Chacun des deux étudiants que nous avons interviewés a dû d’abord déposer avant la fin de l’année civile précédant sa venue en France un dossier d’inscription dans trois universités maximum. Entièrement dématérialisée, la démarche se fait sur la plateforme en ligne “Etudes en France” du site “Campus France”, organisme dépendant du ministère de l’enseignement supérieur, présent dans 72 pays ou territoires.
En attendant les réponses, chacun, dans son pays, a eu un entretien en présentiel avec un conseiller Campus France qui a pour mission d’évaluer la motivation et la pertinence des projets sur le plan pédagogique et de s’assurer de la disponibilité de ressources financières suffisantes – au moins 615 euros par mois (bourse, ressources personnelles, etc.), condition pour obtenir un visa- et d’un logement en France. Puisque les enseignements dans le pays de départ ont été dispensés en français, il n’y a pas de test de langue. Suite à l‘entretien, le conseiller a envoyé un compte-rendu aux établissements contactés. Ceux-ci ont dû répondre aux candidats avant fin avril.
Après avoir choisi parmi les universités ayant éventuellement donné une suite favorable, et après validation du choix par Campus France, chacun a demandé un visa auprès de l’ambassade de France en justifiant à nouveau de ses ressources et d’un logement en France. Une fois arrivés en France, en vertu de la mise en œuvre depuis 2019 du programme “Bienvenue en France” concernant les étudiants extra-européens, ils se sont acquittés des droits d’inscription à l’université d’un montant de 2850 euros.
Adama est Malien. Serge est Ivoirien. Tous deux sont arrivés en France en août 2023. Au moment de l’entretien, au début de l’année 2024, ils étaient étudiants en licence 3 Sciences pour l’ingénieur à l’université du Havre (France). Afin de garantir leur anonymat, certains éléments ont été modifiés, notamment des noms de personnes et de lieux.
– Comment est venue l’idée de venir étudier en France, au tout début ?
Adama : C’est une longue histoire, une très très longue histoire ! Au tout début, quand je faisais mes études, quand j’étais dans les classes fondamentales, j’avais des cousins qui venaient de la France et qui faisaient leurs vacances d’été au Mali avec nous. Et déjà, de base, on se côtoyait et j’avais un lien très fort avec eux. Donc à ce moment j’avais envie de venir en France. Et quand j’avançais au fur et à mesure dans mes études, je voyais des alternatives. Je me disais un jour, il faut que je vienne étudier en France, pour avoir accès à peut-être… Au tout début, il y avait une idée de… Oui, la France, c’est l’Eldorado, tout est beau, tout est nickel ici et il faut venir. Quand j’ai eu le bac et que je me suis orienté vers les sciences, j’ai demandé à mes parents s’ils peuvent… si je peux faire le Campus France pour pouvoir venir étudier ici. Au début, ma mère m’a dit “non, continue à faire tes études ici d’abord, et aie un diplôme plus que le bac ici. Après on peut voir ce que tu peux faire après.” Et bah… j’étais pas trop pour cette idée, je voulais coûte que coûte venir parce que à ce moment, j’avais des amis, ils ont eu le bac, certains sont allés dans les pays maghrébins, Maroc, Algérie et j’ai un ami qui a presque failli venir en France avec la bourse d’excellence. En fait, ils avaient besoin de 10 personnes, et il était le onzième. Donc, lui, il a été orienté vers l’Algérie.
– Il a été orienté vers l’Algérie par…
Adama : Par le gouvernement. Il y avait des bourses. Avec la bourse d’excellence, ceux qui ont fait le concours ont le choix. Pour ne pas tout perdre, ils peuvent aller dans des pays comme le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie. Mais lui, directement il a été orienté vers l’Algérie, s’il voulait accepter. Et finalement il a accepté.
– Juste après le bac ?
Adama : Oui, juste après le bac. Et moi, j’ai fait pas mal de concours. J’ai été pris à l’école d’ingénieur. (…) Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau familial, en Afrique c’est compliqué. Même pour le concours avant que je le passe, quand j’ai intégré l’école d’ingénieur, déjà je n’étais plus chez mes parents. Mon père est enseignant, ma mère est ménagère, elle n’a pas étudié, et mon père il avait pas le temps. Je suis allé chez mon grand-père qui est fonctionnaire et qui est enseignant en même temps. Ma mère pensait que j’aurais un bon niveau là-bas, parce que lui, financièrement, il est un peu stable. (…) J’ai validé, j’ai eu ma licence au Mali. Après avoir eu ma licence, je suis revenu sur mes pas encore, parce que j’ai demandé à la maman, maintenant il me faut faire Campus, je veux vraiment venir étudier en France. Elle m’a dit “OK, tu as fait ce que je t’ai demandé, on va voir ce qu’il y a lieu de faire pour venir étudier ici”. J’ai dit OK. J’ai essayé d’entamer les procédures, ça n’a pas marché parce que j’avais pas toutes les informations nécessaires, parce que je m’y suis vraiment mis sur le tard. Il y a vraiment plein de choses à faire sur le site Campus, la préparation des dossiers et tout ça. J’ai commencé le master 1 [à l’école d’ingénieur]. La première année ça a pas marché, j’avais choisi Le Havre, le master 1, et j’avais choisi Montpellier, Rennes.
– On peut faire combien de demandes ?
Adama : On a droit à sept choix d’universités. On peut faire les sept choix en licence comme en master 1. Parce que ça c’était mon niveau. Je dois fournir des preuves, certificat de fréquentation, pour pouvoir choisir les classes de M1. J’ai pas été choisi. J’ai fait un recours gracieux auprès des universités pour qu’ils réexaminent d’un peu plus près mes dossiers (…). Parce que la licence, je pense que je l’ai bien méritée, parce que la mention que j’ai eue là-bas c’était Bien. J’ai carrément bossé et je me suis demandé comment j’ai pu ne pas être sélectionné. C’était trop dur, c’était vraiment dur. J’ai continué le M1, j’ai validé, et je suis allé en M2.
L’année passée, j’ai encore postulé. J’avais perdu espoir, mais j’ai encore postulé. J’ai eu… Je suis là mais j’ai fait plein de sacrifices. Il y a eu plein plein de problèmes familiaux parce que mon grand-père m’a dit : “Tu as presque fini ici, pourquoi tu veux aller étudier ailleurs ?” Il y a eu le problème financier parce que les oncles de ma mère, financièrement, ils sont stables, ils pouvaient me faire un prêt pour l’obtention de mon visa. Arrivé ici, je les rembourserais, tôt ou tard, parce que c’est la famille. Mais au final, ils ont dit non, pas de prêt. J’ai dit pourquoi ? Un de mes grands-pères m’a dit : “Non, toi c’est juste un diplôme français que tu veux, tu comprends pas.” Derrière tout ça il y avait un autre truc qui se passait, et moi j’étais pas au courant de tout ça, et là ils ont commencé à dévoiler qu’ils ne voulaient pas m’aider dans ce sens. Au final il m’a dit : “C’est un rêve que tu as, tu peux pas le réaliser.” J’ai dit OK. J’avais baissé les bras. J’en ai discuté avec des amis qui avaient postulé en même temps que moi, au Havre ici, en licence 3 et en master, et j’avais postulé dans d’autres villes, Montpellier notamment encore, Lille et Rennes, et d’autres villes.
– Pour quel diplôme ?
Adama : J’avais choisi trois licences, et quatre masters. Et là, mes amis de l’école d’ingénieur, notamment deux amis avec qui je vivais, m’ont dit que eux ils avaient déjà eu leurs sous- et là mon cas c’était pas pareil. Moi, j’avais eu l’acceptation du Havre en licence 3 et j’ai dit je suis déjà en master, mais si on me dit de venir reprendre en licence 3, ça va me mettre en retard. Mais j’ai demandé l’avis des parents, si ça les dérangeait pas. Moi … c’est pour avoir un meilleur niveau. Je sais que si j’arrive à finir et que je travaille ici un peu, et que j’ai de l’expérience et que je repars au pays, je sais que ça va bouger parce que… Moi, à travers mes expériences, et l’observation que j’ai faite, toutes les personnes qui sont venues étudier en Europe ou en Asie ou où que ce soit, et qui sont retournées en Afrique, au Mali précisément, bah… c’est… en réalité, c’est eux les vrais bosseurs, c’est eux les chefs.
C’est eux qui nous dirigent, en fait. Parce que moi, j’ai fait le calcul. Même si je terminais [au Mali] les études d’ingénieur, je ne serais qu’un ingénieur malien, parce que le niveau, il est restreint dans la sous-région et au Mali, en fait. Et avec ma situation familiale ou financière, et avec les magouilles qu’il y a au pays, sincèrement parlé, ce sera vraiment compliqué pour moi de m’en sortir. Seul, je peux m’en sortir. Mais il y a mon père qui est là, il y a ma mère qui est là, et mon père… L’histoire c’est que lui il a eu un accident et depuis il ne travaille pas. On essaie de joindre les deux bouts, moi je faisais des petits boulots, j’essayais de rapporter des choses. C’est pourquoi je sais que tôt ou tard… On est quatre en famille, il y a ma sœur et mes petits frères. Je suis le premier garçon, et logiquement, c’est moi qui dois prendre le relais, quoi.
Serge : Qui doit rapporter le pain à la maison.
Adama : Oui. Après l’acceptation [pour une licence en France], j’ai pas eu de sous, et ils ont commencé à faire les démarches pour le visa, et moi j’ai attendu, attendu. Et l’idée qu’on a eue au final, c’est de faire un prêt, de faire un prêt à qui veut le donner. À mes amis, en fait. S’ils pouvaient me faire un prêt, pour que je puisse… En fait, je travaillais avec une agence. On travaille tous avec une agence qui nous aide pour nos études et tout, qui nous aide pour les procédures de Campus.
– Une agence gouvernementale ?
Adama : Non, c’est une agence indépendante. C’est des structures qui sont là pour aider les jeunes étudiants qui n’ont aucune idée des choix, ou comment monter un dossier pour postuler dans une université à travers Campus France et Parcours sup et tout ça. Ils sont là pour ça. J’ai expliqué la situation au monsieur, je m’entendais bien avec lui, c’est lui qui gérait mon dossier. Il m’a dit si je peux amener deux millions cinq cents de francs CFA, il va essayer de voir.
Serge : Environ euh… 3500 euros.
Adama : Oui, 3500 euros. Or le visa c’est 5 millions [de francs CFA, soit près de 7380 euros]. Ça, c’est la garantie, en fait. Parce que 7380 euros [la somme exigée pour une année, soit 615 euros par mois], si je peux amener la moitié, lui il va compléter pour que je puisse postuler pour le visa. Et là, j’ai demandé des prêts à des amis, certains qui étaient là [en France] et d’autres qui étaient au pays. Là, j’ai pu avoir la somme et je suis allé le voir, il a fait le nécessaire comme il a promis et j’ai postulé après tout le monde, et j’ai obtenu mon visa. Et là, il y avait la sœur de ma mère, qui travaille aussi dans une des entreprises de mon grand-père, celui qui m’a refusé. Elle m’a acheté mon billet, et elle m’a donné des sous aussi pour euh… voilà, quand je serai là, quoi. Donc, entre-temps, je suis venu.
– Vous parliez de vos cousins qui reviennent en vacances l’été au Mali. Ils sont étudiants ici ou ils travaillent ?
Adama : Ils sont jeunes. Il y en a un qui a le bac, un autre qui est en train de faire son bac, un qui a le bac pro.
– Ici ?
Adama : Oui, ici. Ils sont là, ils vivent ici, ils sont nés ici.
– Ah oui. Et le reste de la famille est au Mali ?
Adama : Oui. En fait, eux, ils venaient, mais le lien… En fait c’est un lien familial, mais c’est pas comme si euh… On s’entraide dans ce sens-là, au niveau financier. Mais c’est la famille quand même. En fait, c’est la famille lointaine, quoi.
– Donc c’est eux qui vous racontaient comment ça se passe en France, qui vous ont donné envie…
Adama : Ils avaient pas trop l’idée, mais j’aimais leur style de vie, grave ! Et j’aimais comment ils étaient, et ce qu’ils me racontaient et ce que je voyais à la télé, parce que je suivais beaucoup les dessins animés et tout ce qui était en rapport avec la France et tout ça. Et moi, pour la petite histoire, je ne regardais que – ça fait quoi ? cinq ans que je regarde le journal de la France, TF1 et France 2, et aussi le JT de 19-20.
– Ah ! motivé !
Adama : Oui, motivé. J’ai jamais passé par l’esprit de vouloir venir par la mer Méditerranée. Je me dis si j’ai pas la chance de venir en mode études, je préfère rester là-bas et m’en sortir.
– Donc vous êtes arrivé cette année, en licence 3 ?
Adama. Oui, cette année avec la chance. J’ai eu à payer ma première tranche. La politique de l’université ici fait que ces derniers temps, quand on vient ici, les étudiants étrangers paient 2770 euros et la prochaine année, on ne paie plus ça, ils nous font une exonération. Donc, j’ai payé ma première tranche. J’attends de payer ma seconde tranche dans pas longtemps. Je m’attendais à tout ça, parce que c’est un truc que j’ai préparé depuis. La société [l’agence] m’a donné des questionnaires. On savait, si on venait, comment ça va se passer, ce sera dur et tout, comment il faut s’y prendre pour vivre et étudier et aller dans ce sens. Donc, ça fait pas mal parce que je l’ai choisi. Et là, bah, j’ai eu un boulot, en octobre. Voilà, je fais un job étudiant en même temps que les études, je gagne à côté.
– Vous travaillez combien d’heures par semaine ?
Adama : Je travaille 18 heures par semaine. J’essaie de faire le week-end, et souvent, les fins de semaine j’essaie de faire 5 heures, 5 heures souvent.
– Qu’est-ce que vous faites ?
Adama. Je travaille dans un restaurant à une trentaine de kilomètres d’ici.
– 30 kilomètres !
Adama – Oui. La responsable est gentille parce que quand je lui ai dit, je suis étudiant, je peux pas travailler à temps plein, je peux travailler en mode extra. Je connaissais pas le contrat, mais elle m’a tout expliqué. Je savais qu’en tant qu’étudiant, je ne peux travailler qu’un certain nombre d’heures. On est limité par an. Elle a compris, elle m’a dit OK. Mon emploi du temps [d’étudiant], si en fin de semaine je peux travailler, je lui envoie mon programme chaque début de semaine. Elle, elle fait le planning de la semaine, elle m’intègre et voilà, on y va comme ça. Et elle m’a fait cette faveur-là. Je partais chaque fin de semaine, elle prend en compte mes heures de bus et tout. Je pars, je travaille, normal. J’arrive à faire mes études. Je ne manque pas mes cours, je fais le maxi pour y aller, et voilà. Jusque-là, sans problème pour le moment. Et j’ai même pu rembourser les gens à qui j’avais fait le prêt, je les ai remboursés, j’ai commencé, et voilà. C’est une histoire. C’est un rêve, quoi !
– Et pour vous, Serge, comment ça s’est passé ? L’idée de partir, le tout début, comment c’est venu ?
Serge : Moi, d’abord, j’ai eu quand même une éducation assez stricte, assez rigoureuse au niveau des études et du comportement et tout, vous voyez. (…) J’étais un élève brillant et tout, premier de classe. Le directeur de mon école a proposé que je parte dans un lycée d’excellence. Parce que dans mon pays, la Côte d’Ivoire, il y a un lycée d’excellence qui forme les scientifiques qui, après l’obtention du bac, soit partent en France, soit en Angleterre, soit restent en Côte d’Ivoire mais dans un cadre scientifique appelé l’INP-HB [Institut national polytechnique Houphouët-Boigny], c’est-à-dire c’est comme l’X Polytech ici. Et qui forme des ingénieurs, des polytechniciens après des classes prépa. Donc, c’était déterminé, dès la 5e, c’était déjà l’objectif. Tout était déjà tracé. En 4e, j’intègre le lycée d’excellence. (…) En 3e j’ai eu le brevet. Et je suis allé chez un tuteur, l’ami de mon père. Il habitait dans la ville où il y avait un lycée. (…) L’ami de mon père était hyper gentil, sa femme aussi, ils m’ont appris certains trucs que mes parents jugeaient “non, fais pas ci, non, c’est pas pour toi”. Ils m’ont appris la vie, franchement, oui. Après, j’ai obtenu le brevet, le BEPC. (…) La seconde, c’était bien, je me suis habitué au lycée. Et en première, j’ai fait la première C, scientifique. (…)
Après ça, je me suis dit ah ! je suis en première C, normalement après, c’est la terminale C. Je me suis dit non, sachant que je suis quand même bon en science, et polyvalent, pourquoi pas faire un bac expérimental, pour me donner plus de chance d’avoir une mention, pour me permettre d’être directement affilié à la France ou à l’Angleterre ou entrer directement à l’INP-HC ? C’est dans ce choix-là.
Au début, mon père n’a pas compris. Il m’a dit : “Non, mais t’es fou ! On a déjà tracé tout. Normalement, tu fais une première C, une terminale C, et tu rentres directement à l’INP-HB dans le cycle préparatoire, après tu deviens ingénieur. Qu’est ce que tu nous fais, là ?” J’ai dit : “Non, je connais mes capacités, ce dont je suis capable, laisse-moi faire si t’es pas d’accord. On verra”. À contre-cœur, il m’a laissé faire. J’y suis allé, et j’ai majoré, j’étais parmi les trois premiers. Et après, puisque j’avais fait un parcours scientifique, et là j’avais fait sciences expérimentales, [je suis] quelqu’un qui est polyvalent, le baccalauréat c’était facile pour moi. J’ai eu le bac avec la mention Bien, j’ai obtenu 295 points. Le hic, c’est que pour les bourses d’excellence, et pour la France et l’Angleterre, pour la terminale C, il faut 280 points, mais pour la science expérimentale, il faut 300 points ! Donc il y a eu un petit pincement. (…)
Lorsque les bourses arrivent, c’est d’abord notre lycée qui est visé parce que c’est là-bas qu’il y a [fait le geste entre guillemets] les “cracs”. Campus France, les délégués de certaines universités, il y a X Polytech de Paris, la prépa d’Angers, ils viennent déjà informer dans notre lycée, ils viennent chercher les …
Après le bac, j’attendais ma bourse. Mais après j’ai vu que, non, c’était compliqué. Mon père avait une connaissance au ministère de l’intérieur, je crois, qui a su que j’avais eu le bac, donc… Puisque voilà, il y a l’l’INP-HB qui est tracé déjà, mais puisque j’ai pas eu la bourse, j’irai à l’INP-HB. Et à l’INP-HB, il y a deux phases.
Pour entrer en prépa, il y a l’étude du dossier, et il y a le concours. L’étude du dossier, nous, d’abord, nous sommes priorisés parce qu’on vient d’un lycée quand même qui est difficile. Donc quelqu’un qui a 13 de moyenne déjà, il est automatiquement sélectionné. Donc, l’étude de dossier, c’était à ma portée. J’avais 13 et quelques, ils m’ont présélectionné. Mais au concours, ça a pas été le cas. J’étais sur liste d’attente et puis, bon… finalement ça s’est pas fait. Mon père a voulu que je fasse les sciences économiques. Il a voulu ça. Donc, je partais directement à l’université.
Mais je me suis dit, je veux pas faire tout ce parcours-là. Sachant que c’était soit une bourse d’excellence pour la France ou pour l’Angleterre, soit l’INP-HB puis, après deux ans de prépa, rejoindre la France ou l’Angleterre. Ou continuer en cycle ingénieur.
Je me suis dit non, je suppose que mon père a quand même des connaissances qu’il peut appeler pour que… pour voir, parce que je suis pas nul. J’ai obtenu quand même la mention et tout, et puis… je me suis dit je pense qu’il y a quand même une bourse pour moi. Donc il a appelé et il y a le directeur du lycée qui a recueilli les mentions et qui a appelé mon père et qui a dit, il y a une bourse qui est disponible, mais c’est pour le Maghreb, la Tunisie.
Après plusieurs réflexions, mon père était pas d’accord, mais je lui ai dit : “Laisse-moi y aller, je vais faire ma propre expérience. J’ai déjà vécu loin de vous, même si c’est le même pays, mais je sais que les conditions de vie, l’internat, ça m’a forgé, donc je me sens capable d’aller à l’étranger pour voir plus loin de mon nid”. La mère c’était difficile, les mamans, c’est toujours difficile. La première année après le bac je suis allé directement en Tunisie. Mais il y avait le Covid.
Adama : Confinement et tout ça…
Serge : Oui, confinement et tout le protocole. On est arrivé en décembre, le semestre est déjà terminé. Mais on nous a fait composer, et quand même je m’en suis sorti.
– En quelle discipline ?
Serge : En sciences pour l’ingénieur. Oui, parce que mon père voulait que je sois orienté en sciences économiques, mais le père de ma mère a voulu que je fasse les sciences. Il suivait mon parcours de loin, il m’a dit, qu’après le bac, il allait m’orienter, parce que lui, je pense, il a fait la chimie, je sais pas, mais il a voulu que je fasse le génie électrique.
– Vous étiez à l’université, en Tunisie, ou dans une école d’ingénieur ou… ?
Serge : J’étais dans un institut.
Adama : Un institut scientifique, à peu près polytechnique.
Serge : Oui, à peu près, c’est à peu près les mêmes formations. La première année s’est bien passée, j’étais parmi les premiers. Ensuite, la deuxième année, j’ai été orienté, j’ai choisi l’option électrotechnique parce qu’en deuxième année directement, là-bas, on se spécialise. J’étais spécialisé en électrotechnique. Là-bas aussi, avec la mention Bien, j’ai pu connaître… Déjà, là-bas, c’était plus facile de postuler dans les universités ici [en France] avec les formations que la Tunisie proposait. Parce qu’il y avait des professeurs là-bas [en Tunisie] qui venaient donner des cours ici, et des professeurs ici qui venaient donner des cours là-bas. C’était un peu plus facile de postuler de la Tunisie à ici que de l’Afrique de l’ouest à ici. Avec de bonnes moyennes, j’ai voulu postuler… parce que je pouvais postuler dès la deuxième année de licence pour entrer en licence 3 ici. Mais j’ai dit non, déjà pour les moyens financiers, pour laisser un peu les parents respirer et pour structurer un peu ma manière de voir les choses. Parce que je ne veux pas aller dans un pays qui est prévu pour faire trois ans pour avoir un diplôme, mais partir après la deuxième année et ne pas faire le diplôme pour lequel tu es venu. Donc je me suis dit tu es là pour trois ans, fais tes trois ans, et à la sortie, tu pars en France pour continuer. Campus France, la structure officielle, permet de choisir sept universités. Avec la moyenne du bac, avec la moyenne que j’ai obtenue et tout, ça m’a permis d’être accepté par trois universités.
– Donc, vous avez eu le diplôme au bout des trois ans en Tunisie ?
Serge : Oui au bout des trois ans, en 2023.
– C’est à l’été 2023…
Serge : … que j’ai soutenu et j’ai obtenu le diplôme avec la mention Très bien. C’était déjà un chapitre de fermé. Mais avant de soutenir, j’avais déjà les acceptations des écoles.
– Le moment où on postule, c’est quand ?
Adama et Serge : D’octobre à janvier
– Vous avez choisi sept universités ou c’est Campus France qui…
Serge: Non, j’ai choisi sept universités et j’ai eu trois réponses favorables. Après, moi-même par choix ou en concertation avec mes parents, j’ai finalement choisi Le Havre.
– Pourquoi ? Vous aviez la possibilité d’aller où ?
Serge : J’avais l’université de Mulhouse, et l’université de Strasbourg.
– Et vous êtes venu au Havre.
Serge : Oui. D’abord Le Havre, c’est un peu plus proche de Paris. Et je me suis dit, il y a mes oncles qui sont à Paris et environs, c’est plus facile d’aller voir la famille et Paris c’est pas loin si par exemple il y a les stages. Et aussi il y a le calme. Moi, je suis quand même introverti et quelqu’un qui reste à la maison. Je me suis dit Le Havre, pourquoi pas ? Donc j’ai finalement choisi Le Havre et la formation aussi qui est proposée, ça allait. Ça allait avec plus ou moins ce que j’ai fait (…), c’est une autre licence qui sera dans mon CV. Parce que c’est comme si j’ai deux licences de deux pays différents. Et après entamer soit un cycle ingénieur, soit un master en fonction du domaine que je vais choisir finalement.
– Et vous Adama ?
Adama : Moi, je vais faire le master. J’espère bien finir une bonne année ici et entamer le master. On aura le choix pour plusieurs masters et déjà, Le Havre propose de très bons masters, dans le domaine aussi. Et il y a d’autres villes, mais pour le moment, mon histoire prioritaire, c’est Le Havre d’abord. D’abord, j’ai pas vu les autres, et j’ai pas encore postulé pour avoir des retours. On attend encore les résultats du premier semestre. Et pour revenir un peu à ce qu’a dit Serge, Campus France, c’est une structure qui est là pour les étudiants étrangers pour avoir… Campus France c’est un lien entre les étudiants étrangers et les universités françaises, dans toutes les villes en France. Donc les étudiants étrangers postulent. Au début on crée un compte, et on met nos diplômes des trois années, à partir du bac, la licence et les relevés des trois derniers semestres. Après il y a une période pour créer son profil et postuler. Quand on postule, on a accès à… on paie une somme d’abord pour que Campus France puisse valider aussi, parce qu’il y a des travailleurs de Campus dans les instituts français qui nous donnent accès aux universités. On choisit et les universités font un retour durant une période, et voilà.
– Vous postulez par internet, ou il y a un entretien ?
Adama : Oui, par internet, et oui, il y a un entretien pédagogique pour voir si réellement la personne qui a postulé, elle a les atouts, est-ce que c’est réellement lui qui… voilà… tout ce qu’il est en train de dire dans son dossier, il y a une lettre de motivation qu’on doit envoyer. Après ce qu’on postule, on a un entretien physique…
Serge : C’est pour voir si ce que tu dis est réellement le fond de ta pensée ou c’est par quelqu’un qui a écrit pour toi.
Adama : Tout ce qu’il y a dans ton dossier. Parce que le monsieur, il a ton dossier, il l’a étudié déjà, il l’a en face de lui.
– C’est un entretien qui dure combien de temps ?
Adama : C’est un entretien qui peut durer, euh… Moi, le mien…
Serge : 15-30 minutes.
Adama : Oui, 15-30 minutes. Mais le mien, ça a été rapide, très rapide, parce que j’avais 28 questions, 28 réponses.
Serge : Ah oui ! 28 !
Adama : Oui, 28 questions que j’ai répondues, j’ai cherché, j’ai fouillé et…
– Il vous a posé 28 questions, ou vous aviez, vous…
Adama : Non, le monsieur ne m’a pas posé 28 questions, il m’a juste posé cinq questions mais dans ces cinq questions qui étaient dans les 28 questions que j’avais… Et là je suis venu, c’était très rapide, et très fluide.
Serge : En fait cet entretien, c’est juste pour voir si t’as de la suite dans les idées.
Adama : Parce qu’il se peut qu’il y ait des escrocs qui s’inscrivent et qui n’ont pas le niveau, ou qui font des faux diplômes, ils viennent avec. C’est pas logique qu’ils envoient ces dossiers vers les universités françaises. Et déjà, après cet entretien, ils font des appréciations, ils disent telle personne oui, il est bon, j’apprécie ou j’apprécie pas, à ce niveau il est comme ci, il est comme ça.
– Vous n’avez pas passé de test de langue
Adama : Non parce qu’on étudie…
Serge : Nous sommes déjà francophones. Moi j’ai étudié dans les pays arabes, maghrébins. Eux, par exemple les Tunisiens, ils passent aussi par campus France, ils ont besoin d’un test de langue.
Adama: Oui parce qu’en fait, ils étudient dans deux langues, l’arabe et le français.
– Et vous Adama, vous avez étudié en français ?
Adama : Oui complètement en français. Au Mali notre langue de travail c’est le français, on est obligé.
– Et vous Serge, l’enseignement était en français dès le début ?
Serge : Oui c’était en français mais bon, comme c’est pas leur langue de base il y avait quand même un peu d’arabe, de français, mais les écrits c’était en français. On arrivait quand même à comprendre les cours. Mais eux ils ont quand même un test de langue (…). Mais nous, puisque lorsqu’on rentre les dossiers, les documents avec nos passeports et tout, ils voient directement qu’on vient de pays francophones. Ça sert à rien de passer le test de langue.
– Vos parents, ils ont voyagé dans leur vie, ils sont allés à l’étranger ?
Serge : Moi oui, mais bon, c’est dans la sous-région. Ma mère a voyagé, elle est allée au Togo, au Bénin, au Ghana. Mais mon père, non, lui il est resté en Côte d’Ivoire. Il a trouvé du travail là.
– Et vous Adama ?
Adama : Ben moi, mon père il a jamais voyagé. Il est jamais sorti du Mali, et je dirais même de la région où on habite. Et ma mère, elle est née en Côte d’Ivoire, elle a grandi là-bas. Vers l’âge de 10 ans, son père a quitté le Mali pour aller s’installer en Côte d’Ivoire. Et là il avait une entreprise et tout ça et après son décès ils sont revenus au Mali avec ma grand-mère et depuis elle est là, elle a jamais voyagé.
– Et dans la famille un peu élargie, il y a eu des gens qui ont étudié par exemple dans un autre pays ?
Adama et Serge : Oui.
Serge : Oui franchement, chez moi il y en a beaucoup quand même.
Adama : Moi, un de mes grands-pères a étudié en Russie parce qu’il a eu une bourse d’excellence, c’est lui qui a une entreprise au Mali. Après il est reparti. Et j’ai d’autres grands-pères qui sont allés en Autriche. D’autres sont allés en … Un est aux États-Unis, du côté de ma mère. Du côté de mon père… Mon père, c’est le seul qui a étudié, qui a eu le bac et qui a fait l’université. J’ai des cousins, mais qui ont pas trop continué les études, ils sont tous au Mali.
– Il y a une partie de votre famille qui est en France ?
Adama : Oui, il y a une partie. Mais c’est une famille lointaine, en fait. Et il y a le mari de la sœur de ma mère qui est là. Voilà, c’est comme ça.
– Vous, Serge, c’est…
Serge : Il y a de la famille, des frères de mon père, le petit frère de ma mère.
– Qui ont étudié ou qui ont voyagé ?
Serge : Au niveau de mon père, ils ont voyagé, ils ont étudié et ils travaillent ici. Et il y en a d’autres qui font la navette. Et du côté de ma mère, ils sont plus aux Etats-Unis et dans les pays de la sous-région. Il y en a un… lui il a fait ses études, il est médecin, il a fait ses études en Côte d’Ivoire mais il fait la navette. Il est reconnu à l’Ordre des médecins en France. Il fait la navette entre la Côte d’Ivoire et la France. Donc il est quand même régulier ici.
– Vous êtes en France, mais est-ce qu’il y avait d’autres pays qui vous attiraient ?
Serge : Il y avait la Belgique, l’Angleterre. Moi, il y avait la possibilité de choisir entre la France et l’Angleterre après les études du lycée, mais bon… Après, oui, il y avait la Belgique et l’Angleterre. Mais la Belgique, c’est pas facile. C’est pas comme Campus France pour postuler. Y a pas de structures réellement pour les étudiants étrangers.
Adama : En réalité, la France, c’est le seul pays qui a une structure totalement faite, totalement bien structurée pour vraiment la transparence et vraiment être en contact avec l’université. Je n’en ai pas vu dans d’autres pays.
– Pourquoi la Belgique ? Vous avez des liens particuliers avec la Belgique ou…
Serge : Non, j’ai pas de lien mais c’est un pays que j’ai découvert étant enfant, à la télé et tout. Et après, leur culture, ils sont pas tellement présents dans les médias quand même, et ils me plaisent comme ça, comme l’Angleterre et tout. Par exemple, il y en a beaucoup qui raffolent des État-Unis, du Canada et tout. Moi, c’est pas le cas. Je préfère aller en Belgique, en Angleterre, en France, que d’aller aux États-Unis, au Canada, etc.
– Et les pays du sud de l’Europe, l’Espagne…
Serge : Non, moi, l’Espagne non.
– L’Italie…
Serge : Non, c’est pas…
– Et vous avez appris quelles langues au lycée ?
Serge : L’anglais. Je le fais depuis le primaire. Et ici j’ai appris l’espagnol.
– Mais l’Espagne, non !
Serge : Plus l’Allemagne ! (rires) Je sais pas pourquoi !
– Et vous Adama ?
Adama : Moi j’ai pensé à aller dans trois pays, pratiquement. Il y avait la France, en premier lieu, ensuite le Canada, et il y avait la Suisse. Pourquoi ces pays ? Parce que dans ces pays, en France particulièrement, on parle français. En Suisse, il y a une partie, au niveau de Genève, on parle français, et ils peuvent parler d’autres langues, mais ça c’est la plus facile si je venais en mode étudiant et je pouvais étudier. Et au Canada, il y a une partie aussi qui est Québec, qui parle français.C’est plus facile de m’intégrer et de comprendre, voilà. Et la question que vous avez posée à Serge, je vais répondre aussi. Au lycée, j’ai fait deux langues vivantes, l’anglais en premier lieu, et l’allemand en second. J’ai fait un trimestre [d’allemand], c’était rapide. J’ai fait l’arabe aussi, c’était bref et rapide aussi.
– Bref et rapide, c’est-à-dire ? Vous n’étiez pas obligé d’étudier une deuxième langue ?
Adama : On était obligé, mais c’était durant un trimestre, trois mois. Les écoles n’avaient pas trop les moyens de nous faire continuer ces langues-là. Sauf l’anglais, parce que c’est obligatoire. Depuis le primaire. (…)
Serge : Après notre promotion, notre lycée a commencé à faire des cours d’anglais intensifs, à partir de la seconde. Quand tu comptes trois ans, de la seconde à la terminale, en terminale, t’es bilingue… Franchement, ça m’étonne pas qu’ils soient les premiers en Côte d’Ivoire ! Et il y a un réseau d’anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Pour tous ceux qui sont passés ici, scientifiques de la première promotion à la dernière des promotions à venir, il y a un réseau.(…). Par exemple, si tu fais des études en économie, et t’es sorti ingénieur, c’est un réseau. Tu proposes à un aîné, tu lui dis je viens de finir, est-ce qu’il y a possibilité de faire un stage ?
Adama : C’est comme à Polytech. C’est un système qui est là. Juste une petite parenthèse : ce que j’apprécie vraiment chez eux [en Côte d’Ivoire] parce qu’au Mali c’est pas le cas, c’est un peu plus compliqué, parce qu’on n’a pas de réseau. Les gens sont livrés à eux-mêmes. On a des ingénieurs expérimentés qui sont là mais qui nous aident pas trop. On est livrés à nous-mêmes. Par exemple, on sort d’une école d’ingénieur, on a le niveau académique, c’est vrai, mais le niveau professionnel, c’est dur, c’est pas comme à l’école, quoi. Nous, on amène nos calculs, nos modes de vérification académiques, mais il y a des modes de vérification standard sur le terrain qui ne sont pas pareils. Et voilà. Et c’est pas facile d’avoir des stages, parce qu’on n’est pas liés à nos anciens comme ce que Serge a dit. C’est très très important.
Serge : Je pense que nous… notre promotion… Nous, on est les anciens de la 43e promotion du lycée scientifique. On a aussi notre réseau. C’est-à-dire ceux qui ont eu le bac en 2020 au lycée scientifique. Chacun a son parcours. Moi par exemple, j’ai fait le génie électrique. Il y en a d’autres qui font économie, l’architecture etc. Il y a en a qui sont à Dijon, d’autres au Mans, et tout ça c’est un petit réseau dans un grand réseau.
Adama : C’est très important.
Serge : Oui, c’est très important quand même.
– Oui, c’est souvent ce qui se passe dans les écoles, par rapport à l’université, c’est beaucoup plus…
Serge : Voilà, dans les écoles, tout le monde se connaît pratiquement. En résumé, ma vie, elle était une ligne droite un peu tracée quand même, structurée, donc ça va.
Adama : Et moi, voilà, pour donner un exemple -c’est pas encore fini, hein !- quand je suis arrivé là, je me suis dit je vais écrire un livre. À la fin. Tout mon parcours, tout ce que je traverse -c’est pas encore fini, hein ! – mais j’aimerais commencer peut-être à écrire le livre, quand j’aurai un boulot et que je vais commencer à être un peu stable. Mais je vais toujours penser à repartir chez moi. Parce qu’il y a la famille et tout… Il y a les parents. Et moi, j’ai été aidé. C’est vrai que quand j’ai tendu la main, à un moment donné… c’était pas le cas. Mais je veux vraiment aider et tout ce que j’ai manqué, je veux pouvoir aider, quoi.
(…)
– Quand vous êtes arrivés en France, est-ce que vous avez senti un décalage entre ce que vous imaginiez vivre et voir, et ce que vous avez vécu ? Comment ça s’est passé, l’arrivée ?
Adama : Déjà, quand je suis arrivé, c’est comme si je lisais un livre et que je suis en train de… En fait, j’étais en train de rêver, et je suis en train de le vivre en réalité. Parce que tout ce qui se passe là, je veux pas dire c’était prévu, mais… En fait je m’étais déjà préparé mentalement et physiquement à tout ça. J’avais lu plein de choses… On prépare d’abord, pour venir en France, c’est pas du jour au lendemain que tu peux…
– Mais comment ? Vous me disiez que vous regardiez le journal télévisé, par exemple…
Adama : Oui, le journal télévisé, oui, ça c’était une préparation, une ouverture à la culture, pour comprendre votre culture. Mais avant de venir, déjà, quand on prend l’initiative de s’inscrire sur Campus pour pouvoir postuler dans les universités, bah… Les universités mettent à la disposition de Campus leurs programmes, l’activité qui se passe dans leurs villes, les débouchés et tout. Et nous, derrière, c’est un petit boulot qui est là, quand tu postules pour une université, tu regardes les potentialités de l’université, la vie dans cette ville, la cherté et tout ce qui se passe et tout…
– Oui, mais entre ce qui est annoncé, la belle vitrine et puis l’arrivée…
Serge : Est-ce que les médias, est-ce que c’est réellement ce qui s’est passé quand tu es arrivé…
Adama : La seule chose que j’ai vraiment compris, c’est que ce pays est… il faut bosser, faut juste bosser. Quand on bosse… Ce qui est derrière toute cette image qu’on voit [depuis l’Afrique] c’est le travail. C’est tout simplement ce que j’ai compris. Ici, quand tu travailles, quel que soit le boulot, à l’école dans le taf, à un moment donné, durant les congés ou pendant les vacances, tu peux réaliser ce qu’on voit à la télé et tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que j’ai vu, c’est ce que je suis en train de vivre, mais en mode tu travailles pour obtenir ce que tu veux, en fait. C’est pas comme au Mali où c’est calme même si tu travailles pas, t’es pas stressé, t’as pas de problème. Je suis pas stressé ici, sauf quand je travaille pas, quand même, parce que je me dis, à la fin du mois, il y a les dépenses qui sont là, les charges, il faut calculer. Et ce que ce pays-là m’a appris aussi, j’étais organisé, mais je suis encore plus organisé, ici. La vie en France est en train de faire que je suis très très organisé. J’anticipe beaucoup, et ça me permet vraiment de vivre… En quelques mois, j’arrive à me forger.
– Oui, parce que finalement, vous êtes là depuis 4 ou 5 mois, c’est ça ?
Adama : Oui, je suis venu en France fin août.
– Vous aussi, Serge ?
Serge : Oui, fin août.
– Vous vous êtes bien accoutumés ?
Serge et Adama : Oui, oui.
Serge : Moi, ça va, parce que moi particulièrement j’ai plein d’amis ici déjà.
– Que vous vous êtes faits depuis septembre ?
Serge : Non, pas forcément ici. J’étais dans un autre pays. Mais il y a des amis qui étaient déjà là avant moi. On se parle, on s’écrit. Ce qui fait, avec l’avènement des réseaux sociaux, ça fait qu’il y a certaines réalités qui sont plus compréhensibles que lorsque tu vois. Quelqu’un qui t’explique réellement sa réalité, tu peux mieux comprendre. Donc c’est à travers ça que j’ai un peu compris la culture française, la mentalité française et tout, et je me suis dit quand tu viens quelque part et que tout le monde marche sur sa tête, marche sur ta tête…!
Adama : Exactement, c’est ce que je voulais ajouter aussi. L’intégration à la communauté française ou à ce beau mélange, c’est qu’il faut être un caméléon. Comme le disait Amadou Hampâté Bâ, quand tu viens dans le pays des gens, tu n’imposes pas, tu observes et tu essayes de faire comme les autres font, en bien. Et là, ils vont t’accepter plus facilement, tu vas te sentir bien, comme chez toi. Parce qu’il dit la connaissance commence quand on s’est euh… Par exemple si moi je veux apprendre ce que vous, vous faites, il faut que moi j’oublie qui je suis et que je sois vous. Et que je ne compare pas ce que vous me donnez avec ce que moi j’ai dans la tête. Sinon, on est assis en face l’un de l’autre, mais on sera aussi loin que la terre et le ciel. Je suis un caméléon depuis que je suis là et je me suis fait plein d’amis français, Serge et tous les autres dans la classe, et au boulot, on m’apprécie très bien et je me suis fait plein plein plein de collègues. Je peux pas dire amis, d’abord parce que certains ne sont pas mes amis mais des collègues, j’ai appris à faire la différence. Et voilà. J’ai plein de connaissances aussi.
– Vous aussi, vous travaillez, Serge ?
Serge : Non, j’ai pas encore eu l’occasion. Je postule, j’ai pas encore eu de réponses. Je prends la vie comme ça.
– Vous êtes logés en logement indépendant, ou en résidence universitaire ?
Serge : Moi je suis en résidence universitaire, mais lui …
Adama : … chez un particulier
– Et vos loisirs ? Comment vous faites ? Vous allez…
Serge : Il y a le sport. Mais je pense que à notre arrivée on n’a pas eu l’occasion de pratiquer beaucoup de sport. Il fallait se mettre à jour auprès de l’administration française, et il y a les cours en parallèle, il y a tout un tas de choses… Par exemple, ils ont réussi à faire quand même un peu de sport, mais moi, je suis sportif mais j’ai pas eu l’occasion. Mais ça vient… Puisqu’on vient d’arriver, au fur et à mesure on va s’adapter.
Adama : En matière de loisirs, moi c’est le sport, je fais du sport à l’université, et comme on l’a dit, j’avais une petite connaissance de ce qui m’attendait un peu, et là j’arrive à m’intégrer. Je sors pas la nuit, je bois pas, je fume pas. Mais durant quelques semaines, cinq semaines je crois, il y a eu la foire ici, et on venait voir, ça c’est du loisir aussi. Et il y a la lecture aussi. Et au boulot, ils organisent souvent des soirées entre collègues. Je ne participe pas trop mais j’ai eu l’occasion d’avoir un ami -Serge l’a vu l’autre jour- il m’a invité au bowling et voilà. C’était bien.
– Donc, vous n’avez pas rencontré spécialement de difficultés à votre arrivée ?
Adama : Non, pas pour le moment
Serge : Pas pour le moment
– Pas pour le moment ?
Serge : Pas pour le moment parce que voilà…
Adama : Parce que on s’attend toujours à ce que voilà, si .. Il faut toujours anticiper pour qu’il n’y ait pas de problème. Ne pas avoir de problème ni avec la justice, ni avec la police et tout. Jusque là, j’ai pas eu… on n’a pas de problème, quoi.
– Oui, d’accord. Ça se passe bien.
Adama : Ça se passe bien.
– Vous êtes plutôt satisfaits, alors ?
Serge : Oui, en quelque sorte, on n’a pas…
Adama : Si les études ça va…
Serge : Voilà. On est là pour les études, donc si ça va dans les études…
Adama : Si ça va dans les études, on est contents. Mais si ça va pas dans les études…
– Là, vous n’avez pas encore les résultats du premier semestre. C’est pour bientôt ?
Serge : Oui. Franchement ça va pas être fameux, mais bon… on vient d’arriver, donc…
Adama : Oui, après, il faut serrer la ceinture et voilà. On apprend toujours. On apprend toujours, c’est pas parce qu’on a étudié quelque part. Mais on est venu aussi pour le niveau des études.
– Et vous trouvez que le système universitaire est très différent de ce que vous avez connu dans vos pays respectifs ?
Adama : Oui. Ici, c’est très organisé. On a accès à la bibliothèque, on a accès à beaucoup de choses qu’on n’avait pas accès au pays, c’est vrai. Quand on fournit plus d’effort ici, on en voit le résultat. C’est vraiment bien organisé, très très organisé. C’est ce côté que j’apprécie.
Serge : Au niveau organisation, moi je suis déjà habitué, parce que au niveau du Maghreb, ils sont presque similaires à ici.
– Ah oui, c’est proche ?
Serge : C’est proche, oui. Il y a le grand frère d’une professeur qui m’a fait cours [en Tunisie]. (rires). Oui, ça me fait drôle. Quand même, c’est quand même similaire. Bon, après, pour se familiariser avec le système et tout, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. C’est pas tellement différent, puisque que déjà on est dans un système francophone…
Adama : L’avantage, c’est que la langue dans laquelle on étudie, c’est comme notre langue maternelle, en fait. C’est celle qu’on connaît, c’est la chose même quand on te réveille ou quand on est saoul, on peut parler !
Serge : Oui, c’est ça. Au niveau du système universitaire, ça va. Quand même, pour un bosseur, pour quelqu’un qui sait ce qu’il veut, c’est à sa portée, il peut se donner les moyens d’arriver où il veut. (…)
– Vous disiez que vous allez travailler plusieurs années en France pour acquérir de l’expérience et revenir au pays avec un CV qui vous permettra d’avoir une très bonne position et diriger, etc. Mais au cours de ces années-là, vous allez peut-être faire votre vie en France ?
Adama : Pas forcément…
– Rencontrer…
Serge : Oui, quand même.
– Ça doit arriver…
Serge : Franchement, je pense.
Adama : Ça peut arriver. On a des compatriotes ici, on a des Ivoiriennes, des Ivoiriens, on a des Français aussi, on a des maghrébins et tout. Mais souvent tu essaies de voir la personne avec qui tu as la même mentalité. En matière de femme, je pense qu’il n’y a pas une question de couleur de peau et tout ça. Si la personne partage les mêmes idées ou les mêmes idéologies que toi, on peut se mettre ensemble. Dans le cas contraire, on a toujours au pays des cousines lointaines qu’on peut marier.
Serge : Oui, dans leur pays c’est comme ça. (rires). Chez nous c’est pas pareil !
Adama : (rires) Oui, c’est comme ça, c’est comme ça. En fait eux [en Côte d’Ivoire], ils sont plus européanisés, plus Français que nous. Oui, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, c’est plus comme ça.
[1] Propos recueillis par Thierry Dezalay